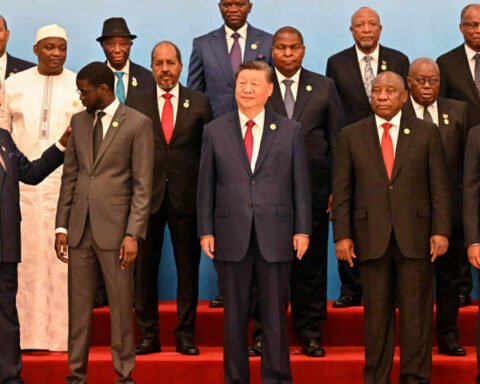Note de l’auteur :
« Il serait naïf, et profondément dangereux, de croire que Dieu, tel qu’imaginé par nous humains, aurait désigné un peuple comme élu parmi tous les autres — comme le revendique Israël — ou que l’Iran incarnerait à lui l’orthodoxie islamique ultime. Dès lors que de telles croyances servent de fondements à une légitimité géopolitique, elles deviennent des instruments de polarisation mondiale. L’ordre international ne saurait reposer sur des dogmes : il doit s’ancrer dans des principes universalisables que sont le droit, la raison et le respect de l’altérité. »
Israël peut-il moralement et stratégiquement légitimer sa « preventive war » contre l’Iran ?
Bien plus qu’un affrontement régional, le face-à-face entre ces deux puissances soulève une question fondamentale : jusqu’où peut-on anticiper la menace sans sacrifier le droit, la morale et l’équilibre du monde ? Cet article, nourri des travaux du philosophe Randall R. Dipert, explore les fondements et les dérives d’une doctrine à haut risque.
The preventive war : Un concept aux contours troubles
Dans la grammaire stratégique contemporaine, peu de concepts sont aussi ambigus, aussi risqués — et aussi exploités — que celui de la guerre préventive.
Longtemps écartée des principes qui encadrent le recours légitime à la guerre, elle a progressivement été intégrée à part entière aux doctrines stratégiques modernes, notamment après le 11 septembre, depuis l’adoption de la National Security Strategy de 2002, où les États-Unis en ont fait un pilier explicite de leur posture militaire.
Désormais, des puissances majeures s’en réclament pour justifier des frappes qui, dans d’autres contextes, seraient assimilées à des agressions pures et simples.
Contrairement à la guerre préemptive — déclenchée face à une attaque imminente —, la guerre préventive repose sur une projection anticipée du danger. Autrement dit : frapper non parce que l’ennemi attaque, mais parce qu’il pourrait le faire demain.
C’est sur cette zone grise que s’est penché le philosophe américain Randall R. Dipert, dans un article majeur qui fait aujourd’hui référence. Son apport essentiel ? Articuler la légitimité de la guerre non seulement à des critères moraux traditionnels, mais à la dimension épistémologique de la menace.
Peut-on savoir que l’ennemi frappera ? Si oui, avec quel degré de certitude ? Et jusqu’où cette connaissance justifie-t-elle un acte de guerre ?
Intéressons-nous d’abord à l’apport de Dipert, qui propose une véritable grille de lecture du soupçon stratégique:
Dipert propose une distinction cruciale. Selon lui, une guerre préventive peut être justifiable si et seulement si elle franchit un certain seuil de connaissance. Cela suppose des preuves solides, des intentions hostiles manifestes, des capacités offensives identifiées, et un contexte stratégique où la menace n’est ni hypothétique ni fantasmatique.C’est ce qu’il appelle la condition épistémologique de la guerre morale.
Elle ne supprime pas les critères classiques de la guerre juste (juste cause, autorité légitime, proportionnalité…), mais elle les complète : ce n’est pas tant ce que l’ennemi est en train de faire, mais ce que l’on sait de manière crédible qu’il s’apprête à faire, qui fonde la légitimité d’un usage anticipé de la force.
Les exemples : entre justifications fragiles et avertissements historiques
1. L’invasion américaine de l’Irak, 2003
Premier cas emblématique d’application abusive de la guerre préventive. L’administration Bush invoque la menace des armes de destruction massive (ADM) pour justifier l’intervention. La guerre est alors présentée comme un acte défensif anticipé.
Or, les fameuses ADM n’existaient pas. Le seuil épistémologique de la menace, selon les termes de Dipert, n’était pas franchi.
Résultat : un conflit long, coûteux, et une crédibilité internationale des États-Unis ébranlée jusqu’à ce jour. L’Irak devient l’archétype d’une guerre préventive injustifiable, au regard tant du droit international que de l’éthique stratégique.
2. L’attaque israélienne contre le réacteur nucléaire d’Osirak – Irak, 1981
Israël bombarde un réacteur nucléaire irakien, redoutant que Saddam Hussein n’acquière la bombe atomique. La communauté internationale condamne l’opération, mais l’histoire lui donnera partiellement raison : la menace était réelle et ciblée, et l’action a probablement ralenti le programme nucléaire militaire irakien.
Selon la logique de Dipert, ce cas peut être considéré comme franchissant le seuil épistémologique, dans la mesure où la capacité offensive, l’intention stratégique et le calendrier de développement étaient vérifiables.
3. L’opération “Outside the Box” contre la Syrie en 2007
De manière plus discrète, Israël frappe un site soupçonné d’abriter un réacteur nucléaire en Syrie. L’opération est un succès militaire, menée sans pertes civiles. Ici aussi, les preuves confirment qu’un programme secret était en cours, en coopération avec la Corée du Nord. L’exemple illustre l’un des cas rares où la guerre préventive a produit un effet stabilisateur, bien que l’opacité israélienne pose la question de la légitimité internationale de ce type d’intervention unilatérale.
Revenons à ce qui fait l’actualité, la guerre préventive d’Israel à l’épreuve du réel
Aujourd’hui, c’est autour de l’Iran que s’articule le plus grand dilemme stratégique contemporain. Depuis des décennies, Téhéran appelle à la “fin d’Israël”, nie sa légitimité en tant qu’État et soutient des milices armées hostiles comme le Hezbollah. Sur le plan doctrinal, ces éléments constituent une intention hostile explicite.
Or, l’Iran développe en parallèle un programme nucléaire civil, dont l’ambiguïté stratégique laisse planer le doute sur ses finalités réelles. Israël, confronté à une rhétorique d’annihilation et à un risque existentiel, estime justifiée une politique de frappes ciblées et de sabotages préventifs (assassinats de scientifiques, virus Stuxnet, frappes sur des installations).
Dans ce cas précis, l’analyse de Dipert trouve toute sa pertinence. Le discours iranien, la nature du régime, le contexte régional et les capacités techniques constituent un ensemble de données qui, pour certains, franchit le seuil d’une guerre préventive justifiable — au nom du principe de non-annihilation.
Néanmoins, cette position exige une rigueur extrême, car mal interprétée, elle peut être perçue comme une doctrine de domination permanente plutôt que de survie nationale.
Le problème, c’est que la guerre préventive est par essence subjective. Elle repose non sur des faits avérés, mais sur des interprétations de la menace. Si chacun juge pour soi ce qu’est une menace “suffisante”, alors plus aucune norme contraignante n’est possible. Les États deviennent juges et parties, la souveraineté devient conditionnelle, et la légitime défense un prétexte.
L’ONU, la Charte internationale, les accords bilatéraux deviennent obsolètes dès lors que la guerre préventive devient une habitude. Les États-Unis, Israël, la Russie (en Géorgie 2008 ou en Crimée 2014), la Turquie (en Syrie), l’Arabie Saoudite (au Yémen) invoquent tous cette logique à des degrés divers. Ce glissement, s’il n’est pas encadré, peut être fatal à l’ordre international.
La réflexion de Dipert ouvre un espace intellectuel fascinant pour penser la guerre dans un monde post-onusien, où l’anticipation devient centrale. Mais cette réflexion n’a de valeur que si elle s’accompagne d’un sens aigu de la responsabilité morale, et d’un respect sincère du droit international.
Oui, certaines guerres préventives peuvent être moralement justifiées. Non, elles ne doivent jamais devenir une habitude politique. Car si nous légitimons l’attaque au nom du soupçon, alors la guerre n’est plus un dernier recours mais une norme diplomatique — et avec elle, disparaît l’espoir d’un monde gouverné par le droit, la paix et la raison.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.