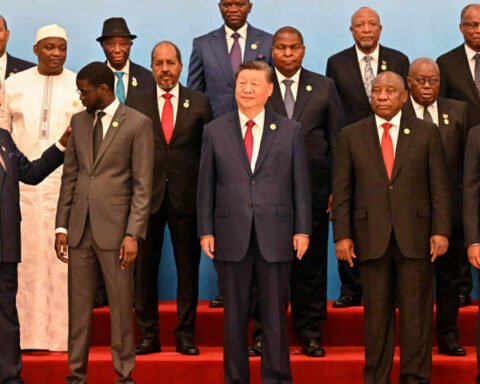Le 13 juin, à l’aube, les Forces de défense israéliennes (FDI), appuyées par les services secrets du Mossad, ont lancé une série de frappes coordonnées et meurtrières contre des cibles militaires et nucléaires en territoire iranien.
L’opération, visiblement préparée de longue date, a aussi visé des figures de proue du complexe militaro-scientifique iranien – scientifiques nucléaires, officiers supérieurs, infrastructures stratégiques. Pas de place au doute : Tel-Aviv a choisi la voie de la confrontation directe.
Cette action unilatérale intervient alors que des discussions laborieuses entre Téhéran et Washington tentaient de renouer un semblant d’accord sur le programme nucléaire iranien. Mais du côté israélien, les dés étaient jetés.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont l’idéologie radicale n’est plus à démontrer, a opté pour la ligne dure : saborder les ambitions nucléaires de l’Iran par la force, quitte à provoquer un conflit majeur.
Comme on pouvait s’y attendre, l’Iran n’a pas encaissé sans réagir. La riposte a été rapide, massive, et surtout symétrique : missiles balistiques de moyenne portée, drones kamikazes, attaques ciblées contre des installations israéliennes sensibles.
Le ton est donné. Ce n’est plus une guerre de l’ombre : c’est un affrontement militaire ouvert entre deux puissances rivales au cœur du Moyen-Orient.
Et derrière ces échanges de feu sophistiqués, ce sont deux civilisations entières qui s’entrechoquent, deux visions du monde inconciliables, avec pour décor un terrain stratégique où tout incident peut dégénérer en guerre régionale – voire mondiale.
Si ce conflit reste contenu militairement, ses répercussions économiques, elles, ne connaissent aucune frontière. Dès l’annonce des premières frappes, les marchés financiers mondiaux ont viré au rouge.
L’or, valeur refuge par excellence, a bondi de 1,4 %. Le pétrole s’est littéralement embrasé : le baril de WTI a grimpé de 7,3 %, atteignant 72,98 dollars, et le Brent a suivi avec une hausse de 7 %, à 74,23 dollars.
Ces hausses peuvent paraître « modérées », mais leur dynamique est inquiétante : si les combats durent, on pourrait aisément atteindre 100, voire 120 dollars le baril dans les prochaines semaines. Et dans ce cas, le monde entier paiera la facture.
Les indices boursiers américains ont immédiatement accusé le coup :
• Le S&P 500 a chuté de 1,1 %
• Le Dow Jones de 1,8 %
• Le Nasdaq de 1,3 %
Les grandes entreprises fortement exposées aux prix de l’énergie ont été frappées de plein fouet :
• Carnival Cruise Line : -4,9 %
• United Airlines : -4,4 %
• Norwegian Cruise Line Holdings : -5 %
À l’inverse, les producteurs d’énergie et les fournisseurs d’armement ont vu leurs actions bondir :
• ExxonMobil : +2,2 %
• ConocoPhillips : +2,4 %
• Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX : +3 % chacun
Pendant que les citoyens ordinaires serrent la ceinture, les géants de la guerre et du pétrole se frottent les mains.
Une hausse continue des prix du pétrole se traduit mécaniquement par une inflation globale. Les coûts de transport explosent, les chaînes logistiques sont sous tension, les matières premières prennent l’ascenseur.
En bout de chaîne, ce sont les consommateurs, déjà fragilisés par l’après-COVID et la guerre en Ukraine, qui verront leurs factures grimper à tous les niveaux.
Les pays importateurs nets de pétrole – Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, mais aussi les États d’Afrique francophone – seront parmi les plus exposés. La situation est encore plus critique pour des économies comme le Venezuela, qui utilise du pétrole iranien pour diluer son propre brut, ou les Émirats, qui achètent discrètement le pétrole iranien malgré les sanctions.
Tout cela reste encore “gérable”, tant que le détroit d’Ormuz reste ouvert. Mais si l’Iran décide de le fermer – même temporairement – le système énergétique mondial pourrait s’effondrer. Ormuz, c’est le cordon ombilical de 20 % du pétrole mondial. Il suffit d’un blocage, même partiel, pour créer un effet domino.
Historiquement, l’Iran a déjà partiellement obstrué ce détroit dans les années 1980. À l’époque, les prix du pétrole ont grimpé de 150 %. Aujourd’hui, dans un contexte où les marges de sécurité sont déjà faibles, un tel scénario pourrait provoquer une flambée de 300 % des prix du brut.
Si Ormuz devient impraticable, les États-Unis, l’Union européenne et certaines puissances asiatiques n’excluraient pas une intervention militaire pour sécuriser la route du pétrole. Une action militaire de ce type ne ferait qu’intensifier le brasier, attirant dans la tourmente des puissances comme la Chine, la Russie ou l’Inde, chacune ayant des intérêts vitaux dans la région.
Autre facteur explosif : les rebelles houthis du Yémen, bras armé de l’Iran sur la mer Rouge. Ils ont déjà multiplié les frappes contre des navires occidentaux. Si le canal de Suez devient un nouveau front, les conséquences sur le commerce mondial seraient désastreuses : retards logistiques, hausse des coûts, augmentation du prix des biens de consommation, notamment technologiques.
Le monde est aujourd’hui suspendu aux écrans des salles de marché, aux bulletins d’information militaire, et aux conférences diplomatiques. Chaque jour de guerre supplémentaire augmente le risque d’un choc économique mondial. Inflation galopante, tensions sociales, récessions en cascade, ruptures de chaînes de valeur… Nous sommes potentiellement à l’orée d’un nouveau krach global.
Et pendant ce temps, certains spéculateurs gonflent artificiellement les prix, usant du prétexte de la guerre pour engranger des profits sur le dos des peuples. Une fois de plus, les conflits armés servent de tremplin aux marchés les plus cyniques.
Alors que l’économie mondiale commençait à peine à se stabiliser après les secousses du COVID et la guerre russo-ukrainienne, un nouveau conflit d’envergure pourrait tout balayer. Si Israël et l’Iran s’enfoncent dans une guerre ouverte, le monde entier en paiera le prix – en carburant, en alimentation, en emploi, en stabilité.
Chaque missile lancé est aussi une bombe à retardement économique. Et chaque jour qui passe sans désescalade rapproche le monde d’un point de rupture.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.