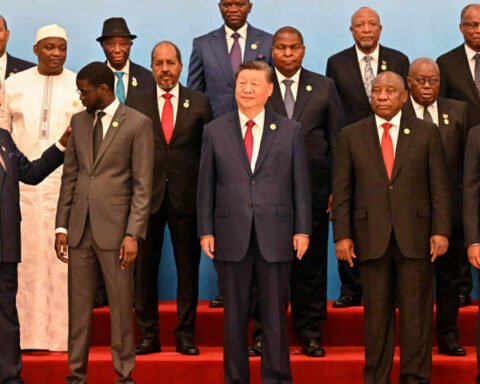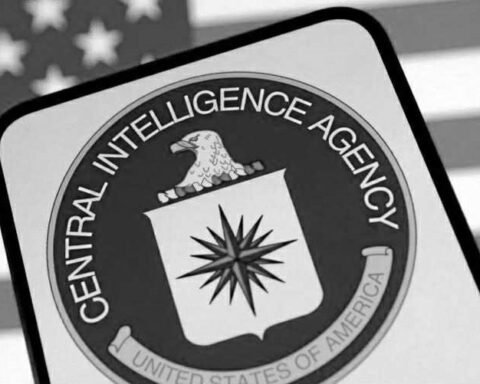Entre autoritarisme rampant et gestion sécuritaire du politique, une zone grise s’installe de l’Afrique centrale jusqu’à l’Ouest du continent. Dans l’espace francophone subsaharien, la Côte d’Ivoire et le Cameroun incarnent deux réponses contrastées aux défis du pouvoir.
L’un se présente comme un modèle de relance post-crise, l’autre comme un rempart contre le chaos régional.
Mais derrière ces vitrines se dissimule un rétrécissement systématique de l’espace politique. Entre gestion autoritaire du dissensus et institutionnalisation du soupçon, la démocratie semble désormais consentie à titre purement formel… à condition de ne jamais menacer le pouvoir.
Côte d’Ivoire : la démocratie sous conditions
Depuis la crise électorale de 2010-2011, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans une trajectoire de reconstruction accélérée. Croissance économique, retour des bailleurs, projets d’infrastructure. Tout semble indiquer un retour à la “normalité républicaine”. Et pourtant, une constante demeure, celle de l’incapacité du système politique ivoirien à organiser une alternance pacifique et équitable.
L’élection présidentielle de 2020 l’a brutalement rappelé. En choisissant de briguer un troisième mandat malgré les contestations, le président ivoirien Alassane Ouattara a franchi une ligne rouge démocratique. Certes, le Conseil constitutionnel a tranché — mais au prix d’un effondrement symbolique du consensus post-crise.
Depuis le décès de l’ex président Henri Konan Bédié en août 2023, le paysage politique ivoirien semble s’être engagé dans une recomposition aussi visible qu’illusoire. L’arrivée de Tidjane Thiam à la tête du PDCI, en décembre 2023, a brièvement ravivé l’espoir d’un renouveau au sein d’une opposition institutionnelle affaiblie.
Mais cet élan s’est rapidement heurté à une mécanique bien rôdée de blocage : la justice s’est saisie de son cas à travers l’article 48 du code électoral, dont l’interprétation controversée remet en question son éligibilité à la présidentielle de 2025. Une manière habile de disqualifier un adversaire sans débat public, par le filtre juridique.
Dans le même temps, l’ex chef d’état Laurent Gbagbo, revenu en 2021, a fondé son propre parti, le PPA-CI, après une rupture avec le FPI, désormais dirigé par son ancien Premier ministre, Pascal Affi N’Guessan.
Cette division du camp historique de gauche, loin d’être anodine, a fragmenté davantage une opposition déjà affaiblie par les années d’exil, les interdictions, et la marginalisation institutionnelle.
Radié de la liste électorale, sa candidature à la présidentielle de 2025 reste suspendue à une éventuelle décision de la Cour constitutionnelle.
Guillaume Soro, enfin, demeure en exil, condamné par contumace, sous le coup de plusieurs mandats d’arrêt, il reste l’objet d’un dispositif judiciaire et sécuritaire constant.
Son entourage est méthodiquement ciblé par des procédures judiciaires. L’exemple le plus révélateur reste celui de son ancien directeur du protocole, Souleymane Koné Kamaraté, condamné en juin 2025 à cinq ans de prison pour recel et blanchiment d’argent. Une affaire perçue par ses soutiens comme une extension de la répression politique par le droit.
Cette stratégie d’étouffement ne vise pas uniquement les figures politiques. Elle s’étend aussi à la société civile. La condamnation en avril 2023 de la militante Pulchérie Gbalet, à cinq ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l’État » après un « simple » déplacement au Mali, en est un marqueur fort.
À travers elle, c’est tout un pan du militantisme citoyen qui est dissuadé de sortir des cadres officiels ou de dialoguer au-delà des canaux gouvernementaux.
Le climat préélectoral de 2025 s’annonce verrouillé : médias sous pression, justice perçue comme alignée, et opposition divisée. Sous couvert de stabilité, un ordre politique de plus en plus fermé s’installe.
Le climat politique s’est encore durci ces derniers mois. En juin 2025, l’ancien ministre et cadre du RHDP , parti au pouvoir, Joël N’Guessan a été entendu et placé sous mandat de dépôt pour avoir publiquement critiqué une décision de justice, estimée contraire à l’indépendance du parquet.
Son arrestation — touchant un proche du pouvoir — illustre un message clair : même les dissidences internes ne sont plus tolérées lorsque la critique s’élève contre le narratif officiel.
Le 22 juin 2025, lors de son allocution au stade olympique d’Ébimpé, le président ivoirien a soigneusement évité de préciser s’il briguerait un quatrième mandat en 2025.
Cette ambigüité stratégique — applaudie par ses partisans, redoutée par ses opposants — installe un suspens permanent, renforçant les tensions autour d’une échéance électorale floue.
Cameroun : une succession sans horizon
Au Cameroun, c’est l’ombre d’un homme qui structure l’État : celle de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. À 91 ans, le président camerounais ne gouverne plus vraiment, mais personne n’ose le remplacer. Le pays fonctionne par inertie institutionnelle, au rythme d’un autoritarisme silencieux.
La répression n’y est pas toujours spectaculaire, mais elle est constante. Arrestations d’opposants, usage sélectif de la justice, instrumentalisation du régionalisme.
À son retour de Paris, où il avait tenu un meeting politique, Maurice Kamto, principal opposant au régime, a été placé sous surveillance à domicile — un dispositif non officiellement reconnu, mais révélateur du climat de contrôle sécuritaire. Cet état de “house arrest” de facto a duré environ 48 heures, avant que les autorités ne lèvent le dispositif sécuritaire le 10 juin 2025, permettant à Kamto de sortir de Douala pour regagner Yaoundé.
Ses partisans, régulièrement interpellés, sont jugés par des tribunaux militaires pour avoir osé contester les précédents résultats électoraux pourtant entachés d’irrégularités.
En 2020, la répression des marches pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a donné lieu à des centaines d’arrestations. Plusieurs figures de la société civile ont été condamnées sans que cela ne provoque de véritable levée de boucliers international.
Plus inquiétant encore c’est la militarisation progressive du politique. Dans un pays en proie à plusieurs conflits (insurrection anglophone dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, menace terroriste dans l’Extrême-Nord), l’argument sécuritaire sert désormais à étouffer toute contestation. On ne discute plus des idées, on surveille les intentions.
À cette militarisation du champ politique s’ajoute une répression silencieuse mais implacable contre la presse indépendante.
En janvier 2023, le journaliste d’investigation Martinez Zogo (Arsène Salomon Mbani Zogo), animateur d’Amplitude FM, a été enlevé le 17 janvier puis retrouvé mort et mutilé le 22 janvier 2023, dans un contexte de révélations sur de hauts dignitaires proches du pouvoir .
Plus récemment, le 7 avril 2024, le cadavre de Sylvie Louisette Ngo Yebel, communicante et ancienne journaliste, a été découvert décapité dans un quartier de Yaoundé .
Ces assassinats, d’une barbarie inouïe, ont suscité une consternation publique à laquelle les organisations internationales — journalistes et défenseurs des médias — ont répondu par une indignation timorée. Aucune avancée réelle n’a été constatée en matière judiciaire puisque les autorités n’ont pas ouvert d’enquête indépendante, et les responsables restent impunis.
Ce qui unit aujourd’hui la Côte d’Ivoire et le Cameroun, au-delà de leurs différences structurelles, c’est une même logique : celle de la “démocratie contenue”. Il ne s’agit plus de nier la démocratie, mais de la canaliser. Élections oui — mais sans réel choix. Liberté d’expression oui — mais dans les limites fixées par l’État. Opposition oui — mais réduite à un rôle décoratif.
Ce modèle repose sur une équation implicite qui se résume au fait que toute contestation est une menace potentielle. Et toute menace justifie des mesures d’exception. On entre ici dans ce que les juristes appellent un “état d’exception permanent”, où le droit devient un outil d’exclusion plus que de protection.
Les lois sur la cybersécurité, sur la lutte contre les fausses nouvelles ou encore sur la sûreté de l’État sont utilisées non pour protéger la société, mais pour neutraliser l’opposant. La critique devient une “cyberattaque”, la dissidence un “complot”.
Ce glissement est d’autant plus préoccupant qu’il bénéficie d’une certaine complaisance internationale. Les deux États sont perçus comme des piliers régionaux. La Côte d’Ivoire, pour sa stabilité économique et son positionnement dans le contrôle de la région du golfe de Guinée. Le Cameroun, pour sa résilience sécuritaire. Dans un contexte de luttes d’influence (France, Chine, Russie, Turquie, etc.), peu d’acteurs osent remettre en cause les équilibres existants.
Mais à quel prix ? Que vaut une paix obtenue au prix du silence ? Que devient un État qui n’a plus d’opposition crédible, plus de médias indépendants, plus d’alternance possible ? La réponse, l’histoire l’a déjà donnée. Ce genre de paix est toujours provisoire. Et elle dissimule souvent une instabilité bien plus profonde.
Dans les années 1990, ces deux pays avaient incarné les espoirs du pluralisme en Afrique francophone. Aujourd’hui, ils deviennent les symboles d’une nouvelle phase, celle de la désillusion. Les régimes s’adaptent, neutralisent sans bruit, et transforment la démocratie en simple procédure sans substance.
Mais la société, elle, n’oublie pas. Les frustrations s’accumulent, les colères se taisent, les exils se multiplient. Et l’histoire montre que les sociétés autorisées à parler finissent par voter. Celles qu’on fait taire finissent, un jour, par exploser.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité..