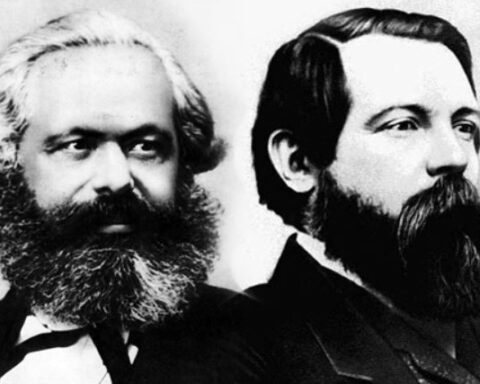L’intensification des opérations militaires israéliennes en territoire syrien à la mi-juillet 2025, menées sous le couvert d’une intervention humanitaire, signale une mutation doctrinale profonde. Derrière le narratif officiel visant à protéger la communauté druze d’As-Suwayda, se déploie en réalité une stratégie israélienne en Syrie qui relève d’une ambition géopolitique plus vaste : le remodelage de l’échiquier levantin par la maîtrise de la fragmentation. Cette approche, qui combine coercition militaire et manœuvres diplomatiques, mérite une analyse rigoureuse de ses fondements, de ses implications régionales et de ses risques systémiques.
Le prétexte humanitaire au service de la stratégie israélienne en Syrie
La justification avancée par Tel-Aviv, centrée sur la protection des Druzes face aux milices bédouines, constitue une manœuvre sémantique et stratégique de premier ordre. En invoquant une responsabilité de protéger une minorité transfrontalière, Israël ne se contente pas de légitimer une projection de force en dehors de tout mandat international ; il établit un précédent normatif potentiellement déstabilisateur pour l’ordre westphalien régional [1].
Cette instrumentalisation d’une solidarité ethnoconfessionnelle poursuit un double objectif. D’une part, elle offre un casus belli flexible, permettant des frappes ciblées sans engager une déclaration de guerre formelle, contournant ainsi les contraintes du droit international classique.
D’autre part, elle promeut activement une vision du Proche-Orient où les loyautés communautaires transcendent la souveraineté étatique. Cette approche s’inscrit dans une tendance lourde de la région, où les identités primaires sont délibérément exacerbées par des puissances externes pour servir leurs propres desseins hégémoniques. La stratégie israélienne en Syrie s’appuie ici sur le concept de « guerre par communauté interposée ».
La fragmentation comme doctrine : le cœur de la stratégie israélienne en Syrie
Les frappes contre des infrastructures névralgiques du régime de transition à Damas, incluant l’état-major et le complexe présidentiel, dépassent largement le cadre d’une simple riposte tactique. Elles révèlent l’axiome central de la stratégie israélienne en Syrie : empêcher à tout prix la reconstitution d’un pouvoir syrien centralisé et potentiellement hostile.
L’objectif n’est plus seulement de contenir l’influence iranienne, mais de reconfigurer durablement la structure même de l’État syrien. En affaiblissant le cœur du pouvoir, Israël cherche à catalyser les forces centrifuges qui traversent le pays. La promotion, même implicite, d’enclaves autonomes sur des bases ethniques ou religieuses – druze au sud, kurde au nord-est, voire alaouite sur la côte – dessine les contours d’une Syrie « balkanisée » [2].
Cette architecture de fragmentation offrirait à Tel-Aviv un avantage géostratégique majeur : la création d’un glacis sécuritaire permanent, composé d’entités plus malléables et potentiellement alliées. Les discours récurrents dans la sphère politico-médiatique israélienne en faveur d’une autonomisation des minorités syriennes ne sont pas fortuits ; ils participent à la légitimation de cette doctrine [3].
Les frictions régionales induites par la stratégie israélienne en Syrie
Cette politique ne se déploie pas dans un vide stratégique. Elle entre en collision directe avec les agendas d’autres acteurs majeurs, créant un environnement de tensions complexes.
La dissonance stratégique américaine
L’administration américaine se trouve prise dans une contradiction flagrante. D’un côté, la diplomatie s’efforce, depuis le printemps 2025, d’arrimer une Syrie post-Assad aux Accords d’Abraham, visant à normaliser les relations avec Israël. D’un autre côté, Washington cautionne, par son silence ou son soutien implicite, une stratégie israélienne en Syrie qui sabote activement cette normalisation par des actes de guerre [4].
Cette ambivalence stratégique américaine, oscillant entre l’intégration diplomatique et le soutien à la coercition militaire, affaiblit la crédibilité de Washington. Elle alimente les perceptions, à Damas comme à Ankara, d’une politique de « double jeu » dont l’objectif final reste opaque, sinon suspect.
La confrontation inévitable avec la Turquie
Ankara observe avec une méfiance extrême les manœuvres israéliennes. Pour le président Erdogan, l’intégrité territoriale de la Syrie est un impératif de sécurité nationale, à condition que cette dernière demeure dans la sphère d’influence turque. Toute tentative de démembrement est perçue comme une menace existentielle.
Le point de friction principal demeure la question kurde. La stratégie israélienne en Syrie, en envisageant un renforcement de l’autonomie des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), est interprétée par la Turquie comme un soutien direct à un proto-État affilié au PKK. Cette perception transforme la Syrie en un théâtre potentiel d’affrontement par procuration entre deux alliés nominaux des États-Unis [5].
Dans cette guerre hybride, Israël pourrait utiliser le levier kurde pour contrer Ankara, tandis que la Turquie pourrait réactiver ses relais islamistes radicaux, créant un nouveau cycle de déstabilisation aux conséquences imprévisibles pour la sécurité d’Israël lui-même.
Les risques et les limites de la stratégie israélienne en Syrie
Si l’approche israélienne peut sembler tactiquement judicieuse à court terme, elle comporte des risques structurels considérables qui pourraient, à terme, se retourner contre ses initiateurs.
Le premier risque est celui de la surextension stratégique (strategic overstretch). En s’engageant dans une occupation de facto de certaines zones du sud syrien, l’armée israélienne ouvre un nouveau front de basse intensité. Ajouté aux tensions persistantes à Gaza et à la frontière libanaise, cet engagement pourrait disperser des ressources militaires et financières précieuses [6].
Le second risque est d’ordre politique et social. L’instrumentalisation continue d’une menace extérieure pour cimenter une société israélienne profondément polarisée pourrait finir par s’éroder. De plus, une politique perçue comme agressive et unilatérale risque d’isoler davantage Israël sur la scène diplomatique, au-delà du soutien américain qui n’est pas inconditionnel à long terme.
Enfin, la doctrine de la fragmentation pose une question fondamentale : peut-on garantir sa propre sécurité en promouvant l’instabilité chronique à ses frontières ? En affaiblissant l’institution étatique syrienne, Israël crée un vide que des acteurs non-étatiques encore plus radicaux et imprévisibles pourraient exploiter. La Syrie deviendrait alors non pas un glacis protecteur, mais un foyer permanent d’instabilité exportable.
En conclusion, la stratégie israélienne en Syrie de 2025 s’apparente à un pari géopolitique audacieux. Celui de substituer à l’ordre des États-nations un chaos contrôlé, un puzzle d’entités communautaires dont Tel-Aviv serait l’arbitre. Si les gains tactiques sont visibles, les coûts stratégiques à long terme – surextension militaire, isolement diplomatique et déstabilisation régionale incontrôlable – pourraient s’avérer prohibitifs. L’avenir de la Syrie, et plus largement l’équilibre du Levant, dépendra de la capacité des puissances régionales à transcender cette logique de jeu à somme nulle pour redéfinir un cadre de sécurité collective. Faute de quoi, la région semble condamnée à une ère de conflits fragmentés et de rivalités exacerbées.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de la rédaction et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.
Références
[1] International Crisis Group – Watch List 2025 – Spring Update (22 mai 2025)