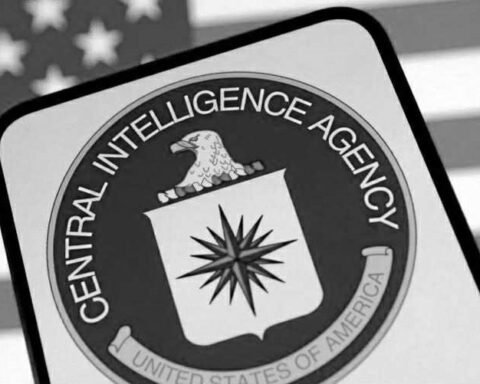1. Des origines impériales à la révolution communiste : naissance d’une doctrine d’encerclement stratégique
La politique extérieure actuelle de Pékin s’enracine dans une matrice idéologique ancienne, où l’État, la centralité et la souveraineté absolue forment les piliers d’une politique étrangère fondamentalement réticulée, hiérarchique et sinocentrée.
Pendant près de deux millénaires, les dynasties chinoises ont cultivé une vision hiérarchique de l’ordre international, centrée sur le mythe du « Royaume du Milieu » (Zhongguo), positionnant la Chine comme cœur civilisationnel autour duquel gravitaient des États vassaux.
La diplomatie impériale reposait non pas sur la conquête territoriale continue, mais sur un système tributaire structuré par la supériorité morale, culturelle et politique de l’empire chinois. Cette conception d’un monde en cercles concentriques, avec la Chine au centre, façonne jusqu’à aujourd’hui l’imaginaire stratégique du Parti communiste chinois (PCC).
Cette vision a été brutalement brisée au XIXe siècle, lorsque les puissances coloniales occidentales infligèrent à la Chine une série de défaites militaires, de traités inégaux, d’humiliations diplomatiques et de mutilations territoriales (Hong Kong, Macao, concessions étrangères). Cette période, connue comme celle du « siècle d’humiliation » (1839–1949), constitue le traumatisme fondateur de la politique étrangère chinoise moderne.
À travers les guerres de l’opium, la révolte des Boxers ou encore l’invasion japonaise de 1937, la Chine subissait une dépossession progressive de sa souveraineté. Ce souvenir douloureux a durablement ancré dans la pensée stratégique chinoise une méfiance viscérale envers les puissances étrangères et une volonté farouche de restaurer une grandeur perdue.
Lorsque Mao Zedong prend le pouvoir en 1949, il s’inscrit à la fois en rupture et en continuité avec ce passé. Rupture, car il rejette le confucianisme, la monarchie et le modèle impérial ; mais continuité, car il hérite du traumatisme de l’encerclement et de l’obsession de l’autonomie stratégique. Très tôt, la Chine maoïste se positionne comme championne du tiers-monde et adopte une posture anticoloniale radicale.
Lors de la Conférence de Bandung en 1955, Zhou Enlai codifie les Cinq Principes de Coexistence Pacifique (respect mutuel de la souveraineté, non-agression, non-ingérence, égalité et bénéfices mutuels, coexistence pacifique) – un corpus doctrinal qui servira de pilier diplomatique, notamment en Afrique.
Mao formalise ensuite la Théorie des Trois Mondes (1974), une grille de lecture géopolitique selon laquelle les superpuissances (États-Unis et URSS) constituent le « premier monde », les pays développés satellites (Japon, Europe occidentale) le « deuxième », et les pays décolonisés du Sud le « troisième » – dont la Chine revendique le leadership.
En se positionnant comme chef de file des nations opprimées, la Chine commence à tisser des liens étroits avec l’Afrique, soutenant matériellement plusieurs mouvements de libération (ANC en Afrique du Sud, FRELIMO au Mozambique, MPLA en Angola), tout en se construisant une image d’allié naturel du Sud global. Ainsi, dès ses origines républicaines, la doctrine géopolitique chinoise s’articulait autour de trois axes persistants :
1. la méfiance à l’égard de l’Occident comme puissance prédatrice ;
2. la quête d’une autonomie stratégique totale ;
3. la construction d’un leadership symbolique sur les pays en développement.
Ces trois piliers vont progressivement évoluer vers un expansionnisme déguisé, transformant la rhétorique anticoloniale des débuts en un projet mercantiliste d’envergure mondiale.
2. L’ère Deng Xiaoping : du repli idéologique à l’expansion économique silencieuse
Avec l’arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir à la fin des années 1970, la Chine amorce un virage décisif. Après la mort de Mao et le chaos de la Révolution culturelle (1966–1976), le nouveau dirigeant abandonne les dogmes révolutionnaires au profit d’un pragmatisme économique assumé.
Ce changement ne marque pas une rupture idéologique totale, mais une redéfinition stratégique des moyens , autrement dit la conquête mondiale ne se fera plus par les armes ni par l’exportation de la révolution, mais par les marchés, la technologie et les flux de capitaux.
La formule qui incarne cette doctrine est célèbre et connue sous le nom de : “Taoguang Yanghui” – « cacher sa lumière et attendre son heure ». Pour Deng, la Chine ne devait plus se confronter frontalement aux puissances occidentales, mais rattraper son retard en silence, accumuler ses forces, et préparer patiemment son retour au rang de grande puissance.
Ce principe restera l’épine dorsale de la politique étrangère chinoise jusqu’à l’arrivée de Xi Jinping. Concrètement, cette doctrine se traduit par les points suivants :
a) Une ouverture contrôlée vers l’extérieur
Dès 1978, les réformes dites de la « politique de réforme et d’ouverture » permettent la création de zones économiques spéciales (ZES), ouvertes aux investissements étrangers. Le commerce devient un outil géopolitique. Pékin entre dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001, mais sans jamais adopter une économie libérale classique : l’État conserve la main sur les secteurs stratégiques, y compris dans leurs aventures extérieures.
b) La naissance d’un capitalisme d’État à visée géostratégique
Dans les années 1990, Deng lance une politique appelée “Go Out” (zou chuqu), officialisée en 1999, encourageant les entreprises publiques chinoises à investir à l’étranger pour sécuriser les matières premières, conquérir des marchés, et s’imposer dans les secteurs-clés de demain (infrastructures, énergie, technologie).
L’Afrique devient rapidement un terrain d’expérimentation idéal pour cette stratégie car ayant une faible régulation, grande richesse minière, élites corrompues ou autoritaires, et besoin urgent d’infrastructures. Pékin y avance ses pions avec méthode, sans bruit, en opposant une diplomatie dite « sans condition politique » à celle, plus moralisante, des bailleurs occidentaux.
c) Le lancement du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC)
Créé en 2000, ce forum marque une institutionalisation de la présence chinoise sur le continent. Il sert de cadre régulier pour annoncer des prêts massifs, des dons, et des projets d’infrastructures dans plus de 50 pays africains. Sous couvert de solidarité Sud-Sud, c’est en réalité un outil d’alignement économique et politique.
À cette époque, la Chine construit les bases d’un mercantilisme d’État moderne, dans lequel ses entreprises d’infrastructure (China Road & Bridge Corp, Sinohydro, etc.), ses sociétés pétrolières (CNPC, CNOOC) et ses banques (Exim Bank of China, China Development Bank) deviennent des bras armés de sa stratégie extérieure.
Tout en proclamant une posture de non-ingérence, la Chine développe en Afrique une présence tentaculaire, basée sur l’endettement, la captation des ressources et la dépendance technologique. Ce n’est plus la rhétorique maoïste de la libération des peuples, mais celle du « gagnant-gagnant » – où Pékin gagne à tous les coups, et l’Afrique… rarement.
Le “cacher sa lumière” de Deng n’était pas une simple posture de prudence mais une manœuvre de contournement, un art d’avancer sans provoquer, tout en redessinant l’ordre économique mondial.
3. L’ère Xi Jinping : fin du camouflage, retour de l’Empire
Avec Xi Jinping, arrivé au pouvoir en 2012, la Chine entre dans une nouvelle phase. Fini le profil bas des années Deng. Le mot d’ordre de Xi est désormais : « la renaissance de la nation chinoise » (zhonghua minzu weida fuxing), un slogan central du projet dit du « rêve chinois ».
Ce rêve n’est pas qu’économique mais également géopolitique, civilisationnel, impérial. La Chine n’ambitionne plus seulement d’être prospère. Elle veut redevenir la puissance pivot du système international — au besoin, en redéfinissant ce système selon ses propres normes. Cette ambition se traduit par trois grands axes d’action extérieure :
a) L’initiative Belt and Road (BRI) : le retour du Grand Jeu
Lancée officiellement en 2013, l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie est le plus vaste projet géoéconomique du XXIe siècle. Elle implique aujourd’hui plus de 150 pays et mobilise, selon la Banque mondiale, plus de 1 000 milliards de dollars d’investissements cumulés.
Derrière la façade du développement d’infrastructures (ports, chemins de fer, pipelines, parcs industriels), la BRI est une stratégie d’encerclement logistique et géopolitique, ce qui veut dire chaque infrastructure est un point d’ancrage de l’influence chinoise. Et chaque prêt accordé à taux bas est une future dette politique.
En Afrique, des ports comme Mombasa (Kenya), Djibouti, ou encore Lobito (Angola) sont intégrés à ces corridors. Certains, comme Hambantota au Sri Lanka, ont déjà été saisis par la Chine après défaut de remboursement. C’est ce que l’on nomme la « diplomatie du piège de la dette », dénoncée par de nombreux experts dont le célèbre professeur indien d’études stratégiques, Brahma Chellaney en 2017.
b) La militarisation diplomatique : l’État-parti comme bras armé
Xi Jinping a aussi mis fin à une hypocrisie; l’idéologie de la « non-ingérence » est désormais un camouflage. Sous Xi, la Chine commence à projeter de la puissance de manière directe :
• En 2017, la Chine ouvre sa première base militaire à l’étranger… à Djibouti, en Afrique.
• Les drones Wing Loong II sont désormais utilisés par des groupes armées ou des milices impliquées dans des crimes de guerre.
c) Le retour du mandarinat impérial : un discours hégémonique
Xi Jinping s’emploie à redéfinir les normes internationales. En 2017, il proclame la création d’une « communauté de destin pour l’humanité », une expression floue mais redoutablement stratégique. Derrière elle, Pékin pousse pour :
• remplacer les normes occidentales par des normes alternatives « non intrusives » (pas de droits humains, pas de liberté d’expression imposée) ;
• renforcer sa place dans les institutions (OMC, ONU, FMI, INTERPOL…) ;
• promouvoir son propre modèle autoritaire comme solution à la crise du libéralisme. Il ne s’agit plus de participer au système international, mais de le remodeler.
4. La Chine en Afrique : de la rhétorique Sud-Sud à la réalité néo-impériale
Depuis deux décennies, la Chine s’est imposée comme le premier partenaire économique de l’Afrique. Ce succès apparent repose sur une stratégie bien huilée, celle de présenter la Chine comme un « allié naturel » du continent, héritier d’un passé commun de luttes anticoloniales, et promoteur d’un développement sans condition idéologique. Mais derrière cette rhétorique séduisante, la réalité est tout autre.
La Chine n’offre pas un « partenariat Sud-Sud », mais une domination structurelle, habillée d’amitié et d’infrastructures, souvent toxiques. Pour comprendre de quoi il est question, analysons ces différents aspects :
a) Infrastructures et dépendance que nous appelons le piège des grands projets
La Chine a financé ou construit plus de 6 000 kilomètres de voies ferrées, 10 000 kilomètres de routes et des centaines d’hôpitaux, stades et barrages sur le continent africain, ce que l’Occident n’a jamais fait après des siècles de présence sur le continent. Ce chiffre impressionne, mais il cache une réalité plus sombre :
• Les projets sont majoritairement conçus, financés et exécutés par des entreprises chinoises, utilisant de la main-d’œuvre importée, au détriment de l’emploi local.
• Une opacité contractuelle extrême entoure la majorité des prêts chinois. Plusieurs rapports du China Africa Research Initiative (CARI) de l’Université Johns Hopkins ont révélé que nombre de contrats comportent des clauses d’exclusivité, des garanties souveraines, voire des droits de saisie en cas de défaut.
• Plusieurs pays sont désormais pris au piège d’une dette insoutenable, comme la Zambie (défaut de paiement en 2020) ou l’Angola (dont la moitié des exportations pétrolières sert à rembourser la Chine).
À travers des mécanismes de « prêts contre ressources », Pékin sécurise ses approvisionnements en matières premières tout en enfermant les États africains dans une spirale de dépendance financière, souvent irréversible.
b) Captation des ressources stratégiques : un pillage sans colonisation formelle
L’Afrique fournit aujourd’hui plus de 25 % du pétrole importé par la Chine, et une part croissante de ses métaux critiques : cobalt (RDC), lithium (Zimbabwe), bauxite (Guinée), terres rares (Namibie, Tanzanie).
• En RDC, la Sicomines, coentreprise sino-congolaise encadrée par des accords signés dès 2008, illustre un cas emblématique : plus de 6 milliards de dollars d’infrastructures promises, mais des livraisons partielles, tandis que la Chine exploite à bas prix des mines de cuivre et de cobalt.
• À Madagascar, au Zimbabwe ou au Ghana, des activités minières illégales menées par des ressortissants chinois sont régulièrement dénoncées pour corruption locale.
• En Guinée, la China Hongqiao Group, en partenariat avec Chinalco, détient désormais une position dominante sur l’extraction de bauxite, au cœur du projet géoéconomique chinois de sécurisation des chaînes industrielles. Ce pillage légal, mené au nom du développement, rappelle une réalité impériale : la Chine ne développe pas l’Afrique, elle y sécurise ses besoins stratégiques.
c) L’influence culturelle et numérique : vers une soft power de l’assimilation
Depuis 2004, Pékin a ouvert plus de 60 Instituts Confucius en Afrique, instruments d’influence culturelle visant à promouvoir la langue, l’histoire et la vision du monde chinoise. En parallèle, la Chine investit massivement dans les réseaux de télécommunications africains à travers Huawei, ZTE ou StarTimes. Cela lui permet :
• d’accéder à des données sensibles, selon de nombreux analystes (cf. scandale du siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, dont les serveurs, installés par Huawei, transféraient des données vers Shanghai, révélé en 2018 par le journal français Le Monde) ;
• de contrôler les infrastructures numériques stratégiques, et donc potentiellement d’exercer un pouvoir de chantage sur les États concernés ;
• de diffuser une narration favorable au régime chinois via des médias pro-Pékin (CGTN Afrique, China Daily). Cette guerre de l’information discrète accompagne la pénétration économique : elle façonne les élites, les récits.
5. Niger : un cas-test de la duplicité stratégique chinoise
Pendant deux décennies, la Chine a consolidé au Niger une influence multiforme, fondée sur les hydrocarbures, les infrastructures, et la diplomatie « sans condition politique ». Le Niger était alors présenté comme un exemple du « partenariat gagnant-gagnant » prôné par Pékin.
Pourtant, depuis le coup d’État militaire de juillet 2023, le pays dirigée par le général Abdourahamane Tiani a levé le voile sur une réalité bien plus inquiétante : celle d’une présence chinoise marquée par le néocolonialisme économique, l’ingérence sécuritaire déguisée, et, plus gravement, une duplicité stratégique dans la lutte contre le terrorisme.
a) Du mirage énergétique à la colère souverainiste
La China National Petroleum Corporation (CNPC) opère au Niger depuis le début des années 2000, notamment sur les blocs d’Agadem dans la région de Diffa. Le projet-phare : un pipeline de 1 982 km, reliant Agadem au port béninois de Sèmè-Kpodji, achevé fin 2023 et censé permettre l’exportation d’environ 90 000 barils/jour.
Mais dès 2024, les autorités nigériennes, sous l’impulsion du CNSP, publient une série de rapports dénonçant :
• des conditions contractuelles léonines en faveur de CNPC,
• des clauses de confidentialité abusives empêchant les audits publics,
• et l’absence de retombées locales durables, notamment en matière d’emploi ou de transfert de compétence. En mars 2025, Niamey suspend partiellement les opérations de la CNPC et exige une renégociation complète du contrat d’exploitation, dénonçant une logique de “dépossession énergétique”.
b) Une accusation explosive : complicité indirecte avec le terrorisme
Le 25 avril 2025, dans une déclaration publique diffusée sur Télé Sahel, le général Tiani accuse frontalement la Chine de duplicité diplomatique et sécuritaire. Il affirme :
« Nous ne pouvons pas continuer à traiter comme partenaires ceux qui ferment les yeux, ou parfois facilitent, la pénétration d’équipements technologiques entre les mains des groupes terroristes qui endeuillent notre peuple. »
Mais plus révélateur encore est un point que le général Tiani souligne dans un rapport au CNSP (rendu public en mai 2025) : la multiplication des enlèvements de ressortissants chinois dans la région de Tillabéri et de l’Est nigérien, suivis de paiements de rançons discrètement autorisés ou tolérés par les autorités consulaires chinoises elles-mêmes.
Selon ce rapport :
• au moins 5 cas d’enlèvements de techniciens chinois ont été recensés entre 2020 et 2024,
• dans chaque cas, des sommes substantielles (de 100 000 à 500 000 $) ont été versées via des intermédiaires locaux pour garantir la libération,
• aucune coopération réelle avec les forces nigériennes n’a été engagée pour intercepter les filières responsables. Tiani accuse la Chine de “financer indirectement le terrorisme par sa politique de rançons systématiques, sans coordination ni transparence”, qualifiant cette attitude de “soutien objectif au chaos régional”.
Ce flux financier discret alimente, selon Niamey, des groupes armés djihadistes actifs dans la zone des trois frontières (notamment le JNIM, affilié à Al-Qaïda).
c) Réaction politique : geler, reprendre, réaffirmer la souveraineté
Dans la foulée, le CNSP engage plusieurs mesures de rétorsion :
• expulsion de plusieurs cadres chinois de la CNPC,
• gel partiel du partenariat militaire avec Pékin,
• fermeture administrative de l’Institut Confucius de Niamey,
• suspension du projet Huawei de déploiement d’un réseau 5G national au motif de sécurité. Le message de Tiani est clair : le Niger ne veut plus d’un partenaire opaque qui avance masqué, s’enrichit des ressources nationales tout en tolérant les mécanismes financiers qui nourrissent les ennemis du peuple nigérien.
d) Un précédent africain lourd de sens
Le cas du Niger n’est pas isolé : il révèle un modèle chinois de présence en Afrique où les ressources sont extraites, les élites courtisées, les conflits locaux instrumentalisés. Mais ici, pour la première fois, un chef d’État africain ose accuser directement la Chine non seulement de prédation économique, mais de complicité indirecte avec le terrorisme, à travers les rançons et les circuits logistiques tolérés.
Cette dénonciation constitue un tournant diplomatique majeur. Elle annonce peut-être la fin de la fiction d’un partenariat sans faille entre la Chine et l’Afrique, et ouvre un cycle de réévaluation stratégique des relations entre États africains souverainistes et puissances étrangères, y compris celles venues de Pékin.
6. Une puissance sans scrupules : le modèle chinois est-il exportable… sans dégâts ?
Ce que révèle, en filigrane, l’ensemble des faits analysés — du virage géoéconomique de Deng à la duplicité stratégique dénoncée par Niamey —, c’est une cohérence doctrinale redoutable : la Chine ne construit pas un nouvel ordre international, elle reconstruit un ordre impérial à visage technocratique, où l’État-parti devient l’instrument d’une domination sans colonisation, mais pas sans soumission.
Pékin ne cherche pas la coopération d’égal à égal avec l’Afrique. Ce qu’elle construit, c’est une zone d’influence obéissante, indispensable à sa sécurité économique et à son rayonnement géopolitique. Et pour y parvenir, tous les leviers sont activés :
• la dette comme outil de pression politique,
• la construction d’infrastructures comme vecteur de dépendance logistique,
• le financement silencieux de groupe armés pour sécuriser son environnement d’affaires,
• la diffusion culturelle contrôlée pour remodeler l’imaginaire collectif,
• et même — comme au Niger — la tolérance d’accords secrets avec des groupes terroristes tant que la stabilité de ses propres intérêts est garantie.
a) De l’aide sans condition à l’asservissement sans contrainte
Le principal mythe entretenu par la Chine reste celui de l’aide sans condition. Contrairement aux bailleurs occidentaux, elle n’exige ni réforme démocratique, ni gouvernance, ni transparence budgétaire. Cette posture attire les régimes autoritaires, mais affaiblit structurellement les États, en les enfermant dans des accords bilatéraux où toute clause échappe au contrôle parlementaire ou citoyen.
La relation Chine-Afrique repose ainsi sur une asymétrie complète : l’Afrique cède ses ressources et sa souveraineté, la Chine fournit les outils de sa propre domination.
b) L’illusion d’un modèle alternatif
Pendant longtemps, Pékin a pu apparaître comme une alternative crédible à l’Occident, notamment après la crise financière de 2008. Son modèle autoritaire, productiviste et centralisé semblait offrir une solution efficace aux États fragiles du Sud.
Mais l’exportation du modèle chinois produit des effets pervers :
• une croissance sans emploi, pilotée par des acteurs étrangers,
• un développement sans industrialisation réelle, dépendant de l’extraction brute,
• une militarisation du politique, renforcée par les livraisons d’armes et d’équipements de surveillance.
À long terme, ce modèle ne renforce pas l’autonomie des États africains ; il les verrouille dans un système de dépendance multiple — économique, sécuritaire, cognitive.
c) Le masque est tombé
La séquence nigérienne marque un tournant : le masque de la bienveillance est tombé. Pékin est aujourd’hui perçue, dans plusieurs capitales africaines, non plus comme un allié stratégique mais comme un prédateur silencieux.
Les accusations du général Tiani — portant non seulement sur l’exploitation énergétique, mais aussi sur les règlements secrets entre la Chine et les groupes armés — ont mis en lumière un fait brutal : la Chine est prête à dialoguer avec toutes les forces, même hostiles à l’État, tant que ses intérêts matériels sont préservés.
Une telle logique n’est pas neutre ; elle est fondamentalement corrosive pour la souveraineté africaine.
d) Ce que l’Afrique doit comprendre : ni l’Occident, ni Pékin ne sauveront le continent
L’Afrique n’a pas besoin d’un nouveau maître. Qu’il s’appelle Washington, Bruxelles ou Pékin, le résultat est le même si l’État reste faible, les peuples désorganisés, et les élites captives. Le choix n’est pas entre deux impérialismes : le véritable choix est celui de la lucidité, de la souveraineté, et du courage politique. En ce sens, Ouagadougou illustre actuellement de façon saisissante cette dynamique.
La Chine, malgré ses promesses, n’offre pas un chemin vers la prospérité partagée, mais une forme d’annexion masquée, via les pipelines, les stades, les bases numériques, et parfois… les rançons. Ce n’est qu’en sortant de la fascination mimétique pour les modèles extérieurs que l’Afrique pourra refuser d’être le champ de bataille entre les empires.
Car le risque est réel : dans cette guerre froide asymétrique entre puissances en déclin et puissances en ascension, l’Afrique redevient ce qu’elle fut durant des siècles : un territoire à exploiter, et non un continent à construire.
Conclusion : La Chine ne sauvera pas l’Afrique
L’Afrique doit cesser d’attendre son salut d’une puissance étrangère. La Chine ne sauvera pas l’Afrique, pas plus que l’Europe ne l’a fait. Derrière son vernis de neutralité et son discours sur le développement, la République populaire agit comme un empire du XXIᵉ siècle : sans soldats, mais avec des contrats ; sans colonies, mais avec des dettes ; sans fouet, mais avec des drones et bases militaires.
La seule voie viable passe par la reconstruction d’États souverains, par la coopération horizontale Sud-Sud authentique, et par la mise en place de contre-pouvoirs internes capables de surveiller, contrôler, et négocier dans l’intérêt des peuples. L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et si les dirigeants africains n’apprennent pas à lire cette rime, le sang, les minerais et les silences d’aujourd’hui écriront demain un nouveau chapitre de soumission.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de la rédaction et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité..