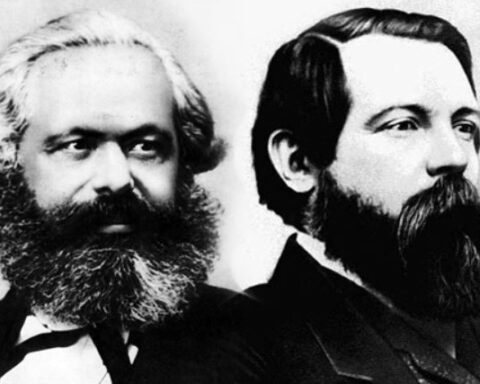Récemment, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré dans une interview que les travailleurs allemands devaient travailler plus dur et plus efficacement.
Quelques semaines plus tard, le chef de file conservateur espagnol Alberto Núñez Feijóo a dénoncé l’augmentation inconsidérée du salaire minimum en Espagne, qui, selon lui, ne représentait qu’un coût supplémentaire pour les entreprises. Le même jour, lors d’une cérémonie commémorant la fin de l’esclavage, Donald Trump a critiqué le nombre excessif de jours fériés et a appelé à leur réduction afin que les États-Unis ne perdent pas des milliards de dollars.
J’aurais pu ajouter d’autres exemples récents, mais assez, c’est assez : je tiens à souligner que ces visions du monde partagées par les dirigeants conservateurs dressent un tableau très sombre de la classe ouvrière occidentale. S’il y a un point commun entre ces dirigeants, c’est précisément leur conception selon laquelle le taux d’exploitation du travail doit augmenter pour qu’une économie « fonctionne bien ».
On pourrait arguer que cela a toujours été le cas, et que le néolibéralisme est, en réalité, une vision du monde issue de cette réflexion. Mais cette fois, quelque chose est différent. Le néolibéralisme fut une réaction historique aux politiques keynésiennes ou sociales-démocrates qui avaient façonné les économies occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale.
Comme chacun sait, ce système institutionnel d’après-guerre reposait sur un accord tacite entre le capital et le travail pour partager les bénéfices de l’activité économique, de sorte que les gains de productivité – dus au progrès technologique, par exemple – étaient répartis équitablement entre le capital (profits des entreprises) et le travail (salaires). Le néolibéralisme qui suivit fut une politique clairement pro-capitaliste, qui s’exprima clairement dans la baisse des salaires (alors que les profits des entreprises continuaient de croître).
Les gouvernements qui ont surfé sur la vague néolibérale à partir des années 1980 ont lancé un démantèlement progressif et radical de la plupart des acquis de la classe ouvrière. C’était l’époque de la « fin de l’histoire », où le libre marché et la mondialisation néolibérale semblaient représenter l’étape ultime de l’histoire humaine.
Les missions de l’État, disait-on alors, se limitaient à quelques fonctions fondamentales qui auraient semblé radicales même à Adam Smith – qui, par exemple, défendait le rôle de l’éducation publique. La crise financière de 2008, la pandémie de 2020, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2021 et la menace sous-jacente que la Chine faisait peser sur l’hégémonie américaine ont finalement brisé cette croyance.
Et, surtout, elles ont contraint les gouvernements à abandonner le néolibéralisme théorique. D’abord, ils ont utilisé l’État pour socialiser les pertes privées ; ensuite, ils se sont tournés vers lui pour intervenir dans le financement des vaccins, faciliter la reprise de l’activité économique et même concevoir certaines politiques industrielles ; enfin, ils l’utilisent désormais aussi pour accroître les capacités militaires.
L’État est redevenu un acteur majeur, mais sous des formes très différentes : il n’est plus occupé à atténuer les conflits de classe, mais se présente comme un instrument brut au service des intérêts du capital national. C’est là que surgit souvent la principale confusion. L’opinion populaire présente l’intervention de l’État comme une idée de gauche, ce qui conduit beaucoup à prendre la rhétorique interventionniste néo-mercantiliste et pro-industrialisation de Trump pour une approche progressiste.
Mais cette perspective est trompeuse, car conservateurs et réactionnaires ont utilisé l’État pour défendre leurs intérêts quand cela les arrangeait. L’État a joué un rôle dans la modulation des conflits de classes à une époque historique donnée, mais auparavant, il avait été largement utilisé au profit d’un camp ou de l’autre.
En réalité, la configuration mondiale actuelle présente bien plus de similitudes avec l’ère du mercantilisme et les débuts de l’économie mondiale à partir du XVIe siècle. Alors comme aujourd’hui, les intérêts commerciaux des empires étaient protégés par la puissance militaire des États émergents, qui s’assuraient les voies d’approvisionnement et les monopoles commerciaux, et par une législation visant à favoriser la croissance des richesses en les capturant par le pillage et la guerre.
La vision de la rareté des ressources naturelles a alimenté cette vision mercantiliste du monde, qui a dominé le paysage international entre 1600 et 1750, mais qui n’a jamais complètement disparu. Dans ce monde des premiers empires modernes, la main-d’œuvre était une ressource peu coûteuse à exploiter. Ce n’est pas un hasard si l’esclavage a accompagné et rendu possible la naissance du capitalisme.
Bien que rarement évoquée, les premières colonies anglaises et françaises des Amériques furent principalement fondées sur des « esclaves blancs » ayant signé des contrats de servitude pour des périodes allant jusqu’à dix ans, avant d’être remplacées massivement par l’esclavage africain. Quoi qu’il en soit, le capitalisme reposait sur ce qu’on appelait l’accumulation primitive : une exploitation brutale du travail qui réduisait les êtres humains à une simple ressource jetable.
Les travailleurs occidentaux étaient exploités librement jusqu’à l’épuisement, tandis que les travailleurs du reste du monde étaient exploités et réduits en esclavage à un degré encore plus grand. Aujourd’hui, les dirigeants conservateurs ne voient pas les choses différemment. Leur objectif est de défendre la position privilégiée de l’Occident et de freiner l’essor des économies asiatiques, qui, entre autres, ont progressé dans le développement en combinant interventionnisme étatique et bas salaires.
Dans cette logique, les États occidentaux se sont déjà réorientés pour assumer un nouveau rôle, beaucoup plus interventionniste et militariste. La résurgence de l’OTAN en est un symptôme évident, mais il faut également inclure ici la nouvelle orientation, apparemment pro-industrielle, des États-Unis et de l’Union européenne.
Dans cette configuration, rien ne laisse présager que l’État sera favorable aux travailleurs ; bien au contraire. Ce rôle modernisé de l’État comporte une composante clairement pro-capitaliste, et les dirigeants conservateurs ne font qu’adapter leurs anciennes visions économiques du monde à la nouvelle ère. Comme à l’ère du mercantilisme, nous nous dirigeons vers un scénario d’États forts et militarisés et d’une classe ouvrière faible, réprimée et désunie.
Les éléments progressistes qui défendent une vision de l’État plus à l’écoute des revendications de la classe ouvrière sont soit trop faibles, soit en recul dans tout l’Occident. Prenons le cas de l’Espagne, où la politique de redistribution des revenus et d’augmentation significative du salaire minimum, qui a éclairé la politique nationale pendant plusieurs années, pourrait finalement être remplacée par un gouvernement réactionnaire qui considère ces améliorations comme ayant été, au mieux, « indiscriminées ».
L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. Le monde émergent n’est pas une anomalie, mais une mise à jour de l’ordre ancien : un capitalisme qui ôte son masque libéral pour se révéler autoritaire, militariste et prédateur. Si la classe ouvrière est incapable de se regrouper, de s’organiser et de remettre en question le sens et l’utilité de l’État, la nouvelle phase du capitalisme sera non seulement plus dure, mais nous ramènera à l’époque où la richesse de quelques-uns était bâtie sur le sang des autres.
Le choix n’est pas entre l’État et le marché, mais entre un État au service du capital… ou au service du travail et d’une vie digne dans les limites de la planète. Bien que, à bien y réfléchir, beaucoup seraient sûrement plus fructueux en poursuivant la énième division au sein de la gauche ou en recherchant des « traîtres » qui ne vénèrent pas les factions bruyantes mais inutiles et diminuées de la gauche.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.