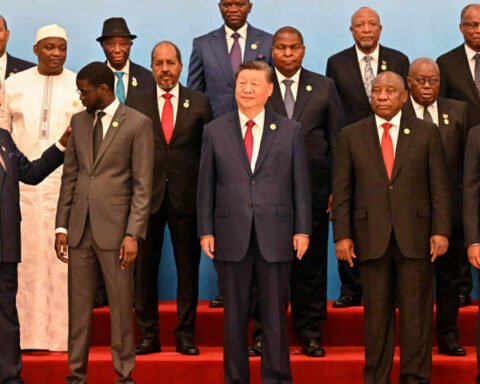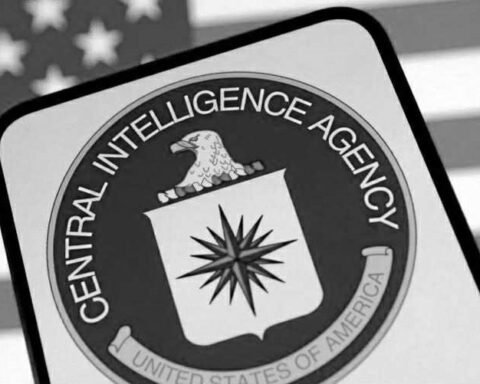Maintenant que les projecteurs se sont éteints, et que les échos diplomatiques de la visite des “cinq volontaires du 9 juillet” se dissipent peu à peu, il est temps de reprendre nos esprits.
Il ne s’agit plus ici de juger sous le coup de l’émotion, ni de célébrer ou de moquer. Il s’agit de comprendre. Car ce qui s’est joué lors de cette rencontre n’est ni un détail de protocole, ni un simple événement médiatique. C’est un miroir tendu aux Africains. Un miroir qui, certes, fouette les égos, mais demeure nécessaire.
À présent, avec la rigueur froide qu’exige l’analyse stratégique, interrogeons-nous sur la nature de cette visite, les postures adoptées, les erreurs commises et, plus profondément, ce qu’elles révèlent d’un continent qui peine encore à se penser comme acteur souverain dans un monde de rapports de force. Conséquence, un continent désarmé face à un monde où l’anticipation stratégique est reine.
Car, pendant que la plupart des grandes puissances — et même des nations émergentes — s’appuient sur des centres de planification stratégiques, parfois secrets, parfois publics, pour anticiper les reconfigurations géopolitiques, technologiques et économiques du monde, la majorité des États africains abordent les grandes scènes internationales sans doctrine, sans ligne, sans boussole.
En Afrique, les décisions restent souvent tributaires de la conjoncture immédiate, de l’instinct présidentiel, ou des agendas dictés par les bailleurs. L’absence de structures autonomes de veille stratégique capables de jouer le rôle de contre-pouvoir intellectuel prive les États d’un regard lucide sur eux-mêmes et les condamne à réagir plutôt qu’à anticiper.
Aux États-Unis, des institutions comme la RAND Corporation ou le National Intelligence Council alimentent en permanence l’exécutif en scénarios d’anticipation.
En Chine, le China Institute of Contemporary International Relations (CICIR) travaille main dans la main avec les organes de renseignement pour orienter la politique étrangère.
L’Inde, de son côté, mobilise des structures telles que l’Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), désormais appelée Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (depuis 2020, en hommage à l’ancien ministre de la Défense), ou le National Security Council Secretariat, véritables cerveaux de la stratégie nationale, qui articulent vision géopolitique, sécurité intérieure et politique industrielle.
En Israël, c’est le National Security Council, adossé aux structures militaires et scientifiques, qui construit les lignes directrices de la survie nationale.
À l’échelle africaine, bien qu’il existe certains centres de réflexion, partiellement indépendants , ceux-ci n’ont ni la portée stratégique, ni la profondeur analytique, ni surtout la fonction de contre-pouvoir intellectuel que l’on retrouve dans les écosystèmes robustes de Washington, Pékin ou New Delhi.
Ce déficit stratégique s’est cruellement manifesté lors du sommet du 9 juillet 2025, où les dirigeants africains, invités par Trump, ont été réduits à des pions dans un jeu géopolitique qu’ils n’ont pas su décrypter.
Intéressons-nous à présent au contexte du sommet :
Le 9 juillet 2025, cinq chefs d’État africains — Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de Mauritanie, Joseph Boakai du Liberia, Umaro Sissoco Embaló de Guinée-Bissau et Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon — se sont rendus à Washington à l’invitation du président américain Donald Trump.
Une fois de plus, des dirigeants africains ont traversé l’Atlantique, non pour défendre une vision, encore moins un projet collectif, mais pour prêter allégeance à une puissance étrangère dans l’espoir d’une aumône ou d’une tape sur l’épaule.
Certains observateurs naïfs reprochent à Trump son arrogance ou sa brutalité. Mais il faut cesser de croire que la diplomatie mondiale est une affaire de morale. C’est une arène, pas un monastère !
L’Amérique ne cherche ni à sauver l’Afrique, ni à la détruire. Elle cherche à neutraliser les zones d’influence chinoises, à sécuriser ses approvisionnements et à contrôler les corridors stratégiques. Point.
Cette diplomatie directe, qui semble rompre par sa frontalité avec les jeux d’influence feutrés du passé, pourrait donner l’illusion d’un changement de paradigme. Fini le paternalisme masqué, place à la négociation brute. Mais cette transparence affichée est peut-être un leurre.
Car en dévoilant sans détour les attentes américaines — accès aux ressources, neutralisation de la Chine, contrôle logistique — elle ne garantit en rien l’équité. Elle place au contraire les dirigeants africains devant un dilemme vertigineux : négocier avec une superpuissance sans disposer des instruments nécessaires pour préserver leur souveraineté.
Et comme l’a montré ce sommet, ils n’étaient manifestement pas préparés à affronter un tel face-à-face.
Inviter cinq chefs d’État africains sans poids géopolitique majeur à la Maison Blanche n’avait qu’un objectif : les instrumentaliser dans une démonstration d’influence.
Dans cette arène impitoyable, les dirigeants africains ont trébuché, victimes de leurs propres erreurs stratégiques, révélant une diplomatie sans cap ni cohérence.
La première erreur stratégique fut l’absence de cap. Aucun de ces dirigeants n’était mandaté par une organisation régionale ou sous-régionale. Aucun n’avait préparé un mémorandum commun, un argumentaire aligné.
Ils ont abordé cette rencontre multilatérale comme une série de discussions bilatérales, chacun vantant les atouts de son pays, pétrole sénégalais, uranium mauritanien, forêts gabonaises etc.
Cette absence d’unité rappelle plutôt les rivalités fratricides post-indépendance, où des États africains, au lieu de coopérer face aux enjeux globaux, ont souvent préféré s’aligner séparément sur des puissances extérieures, affaiblissant ainsi toute possibilité d’agenda commun.
Chacun est venu avec sa petite valise de problèmes nationaux, pensant pouvoir monnayer sa misère contre un prêt ou un appui diplomatique.
Dans le monde diplomatique, cela s’appelle de la mendicité bilatérale. Or, dans le langage des puissances, on ne respecte que ceux qui savent dire “non”, et qui savent pourquoi ils sont là. Un président qui ignore les objectifs de son interlocuteur avant de s’asseoir à la table des négociations n’est pas un diplomate mais plutôt un figurant.
Deuxièmement, les dirigeants ont méconnu l’objectif réel de cette rencontre. Selon Africa Intelligence, des fuites de l’entourage de Trump révèlent que l’invitation visait à sécuriser des contrats miniers avantageux pour les entreprises américaines, notamment dans le contexte de sa rivalité avec la Chine.
Leurs allocutions étaient pathétiques de superficialité. L’un parlait de “potentiel agricole inexploité”, l’autre de “partenariats mutuellement bénéfiques”, sans jamais évoquer la moindre politique industrielle.
Ces erreurs ne sont que le symptôme d’un mal plus profond : une obsession stérile pour les ressources brutes, qui trahit une mécompréhension tragique des dynamiques économiques globales.
L’erreur la plus symptomatique, et celle qui mérite une attention particulière, est ce que nous pouvons qualifier de “religion du sol” qui masque d’ailleurs la pauvreté de l’esprit. Cette « religion du sol » se caractérise par une erreur cognitive majeure qui est le fait de croire que la matière première est la solution.
Lors du sommet, les dirigeants ont énuméré leurs atouts comme si leur simple existence suffisait à attirer des investisseurs. Ce discours, omniprésent dans la rhétorique africaine, repose sur une mécompréhension profonde des réalités économiques.
Comme l’écrivait l’économiste sénégalais Samir Amin dans L’Accumulation à l’échelle mondiale (1970):
« les ressources naturelles ne deviennent richesse que par leur intégration dans un système productif national »
Autrement dit, sans capacités de transformation locale, l’Afrique reste un réservoir de matières premières pour l’industrie étrangère.
Le minerai, c’est l’alphabet. L’économie, c’est la langue. Et les Africains croient qu’en tenant une lettre entre les mains, ils détiennent le livre.
Ce mythe a des racines historiques. Dans les années 1950 et 1960, les indépendances africaines ont suscité des espoirs de développement basé sur les minerais et le pétrole. Pourtant, des pays comme le Ghana exportent de l’or depuis le XVe siècle. Pourtant, ses citoyens, en 2025, continuent de souffrir de pauvreté endémique. Pourquoi ?
Parce que la richesse ne vient pas de ce qu’on extrait, mais de ce qu’on transforme. La vérité est que les matières premières ne sont pas une richesse, mais un point de départ.
Prenons l’exemple du lithium : très présent au Zimbabwe, en RDC, au Mali. Mais ce minerai n’est utile qu’inséré dans des batteries produites dans des usines en Corée, en Allemagne, ou en Chine.
Ce n’est pas un secret; le Mexique possède du pétrole, le Kazakhstan aussi. Mais ce sont les pays qui savent intégrer la technologie, les finances et l’intelligence industrielle qui transforment ce potentiel en pouvoir.
En comparaison, des pays comme la Norvège ont transformé leurs ressources pétrolières en richesse grâce à une vision industrielle et éducative. Depuis les années 1970, la Norvège a investi massivement dans la formation d’ingénieurs pétroliers et la création de Statoil (aujourd’hui Equinor), une entreprise nationale capable de concurrencer les géants mondiaux.
Pourquoi le Botswana est-il plus stable que la RDC malgré des ressources similaires ? Parce qu’il a mis en place un cadre institutionnel de gestion.
Pourquoi le Vietnam, après la guerre, a-t-il dépassé plusieurs pays africains en développement industriel ? Parce qu’il a investi dans l’éducation technique, dans les chaînes de valeur locales et dans une stratégie commerciale orientée vers la transformation.
Et que font les États africains ? Ils continuent d’attendre que le monde vienne exploiter leurs mines, pendant qu’ils n’ont pas un seul institut de recherche régional digne de ce nom sur les minerais stratégiques. Ils ont même le culot d’organiser des sommets miniers… sans laboratoire de métallurgie.
Cette illusion des ressources reflète un vide plus fondamental qui se traduit par l’absence d’une vision claire de ce que l’Afrique veut réellement dans l’arène mondiale, une question que ses dirigeants refusent d’affronter.
Face à ces critiques, certains pourraient arguer que ces dirigeants africains y étaient pour rechercher des partenariats équitables pour stimuler le développement et renforcer leur souveraineté, comme l’appel du président Ghazouani à des investissements dans l’uranium mauritanien ou celui du président Embaló pour des projets d’infrastructure en Guinée-Bissau. Ces appels reflètent certes une volonté faciale de tirer parti des opportunités internationales.
Cependant, cette vision optimiste se heurte à une réalité qui est l’absence de stratégie cohérente qui minimise toutes les chances d’investissement. Cette quête mal définie rappelle les échecs des années 1970, lorsque des pays comme le Nigeria ont dilapidé les revenus pétroliers dans des projets mal conçus, comme la construction inachevée de l’aciérie d’Ajaokuta.
La véritable difficulté pour les Africains, c’est de se questionner. Veulent-ils la souveraineté ? Alors il faudra en payer le prix à travers les réformes des systèmes éducatifs, investissements dans la recherche appliquée, développement de champions industriels.
Veulent-ils simplement survivre dans le système actuel ? Alors qu’ils cessent de se plaindre des règles du jeu. On ne gagne pas à un jeu dont on ne connaît pas les règles.
L’Afrique accuse l’Occident de “vouloir ses matières premières”, mais sait-elle au moins à quoi elles servent ? Peut-elle dire ce que coûte une raffinerie de lithium ? Un centre de fusion du tungstène ? Un aciérage ?
Le drame, c’est qu’ils parlent des ressources qu’ils ne maîtrisent pas, qu’ils ne comprennent pas, et dont ils ignorent les chaînes de valeur. Ce n’est plus de l’ignorance, c’est de l’irresponsabilité.
Le monde de demain ne sera pas fait pour les mendiants stratégiques. Il sera fait pour ceux qui construisent des écosystèmes technologiques, qui maîtrisent leurs sciences et qui savent convertir leurs ressources en puissance.
La visite du 9 juillet 2025 restera comme un avertissement. Elle aurait pu être une opportunité. Elle a été un fiasco. Pas à cause de Trump. Pas à cause de l’Amérique. Mais parce que l’Afrique est venue sans projet, sans cap, sans courage.
Et tant que ses dirigeants penseront que posséder du cuivre est suffisant pour exiger du respect, ils continueront de briller dans les sommets… et de sombrer dans l’histoire.
“Ceux qui ne transforment pas leurs ressources ne transforment jamais leur destin.”
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.