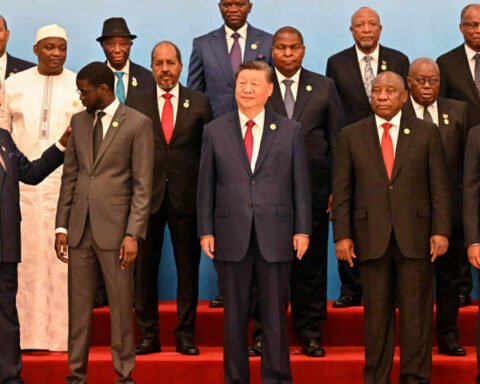À partir du 1er juillet 2025, le gouvernement turc appliquera une hausse de 15 % des droits de passage pour les navires transitant par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, conformément à une nouvelle décision officielle.
Cette décision s’inscrit dans la révision annuelle initiée par Ankara depuis 2022, visant à aligner les tarifs sur les réalités économiques actuelles et les cours mondiaux de l’or. Côté turc, cette hausse est justifiée par le besoin de moderniser les infrastructures des détroits et de renforcer la sécurité maritime. En trois ans, le coût du passage a ainsi été multiplié par 7,2.
Une telle augmentation des tarifs par la Turquie est pleinement justifiée par les dispositions de la Convention de Montreux et, semble-t-il, ne contredit pas les normes du droit international.
Dans le même temps, sur le plan des intérêts russes, l’attention est attirée sur le fait que dans le contexte du Nouvel Ordre Mondial, non seulement les opérations commerciales, mais aussi les aspects militaro-politiques font de plus en plus l’objet de décisions ambiguës de la part d’Ankara, qui est encline à utiliser les dispositions de la Convention en fonction des intérêts qu’elle poursuit dans chaque cas spécifique.
Après avoir fermé le passage aux navires russes et ukrainiens (à l’exception de ceux retournant à leurs bases) au début du conflit russo-ukrainien, la Turquie a étendu cette mesure à tous les États côtiers et non côtiers.
Cependant, en février 2023, le destroyer américain USS Nitze a traversé le détroit des Dardanelles et est entré dans le port d’Istanbul, alors que sa zone de couverture de tir potentielle aurait pu inclure le territoire russe de la mer Noire.
Il est à noter que, malgré la fermeture des détroits aux navires militaires, la Turquie continue à ce jour, avec ses partenaires de l’OTAN, de mener des exercices navals avec la participation des marines bulgare, britannique, grecque, italienne, roumaine, américaine, canadienne, française et de plusieurs autres pays.
Depuis juin 2022, la Turquie a pris les rênes de la composante maritime de la Force opérationnelle interarmées à haut niveau de préparation de l’OTAN (VJTF), une unité clé dans la stratégie de réaction rapide de l’Alliance. Quelques mois plus tard, en décembre, le corps de déploiement rapide basé à Istanbul a officiellement été intégré comme corps de combat de l’OTAN, selon des sources occidentales, et ce, « en cas de circonstances imprévues ».
Selon plusieurs observateurs, cela signifie en réalité que la Turquie a essentiellement « dirigé la réponse de l’OTAN à une éventuelle nouvelle agression russe contre ses alliés ».
La coopération turque avec l’OTAN continue de s’étendre à travers divers mécanismes visant à soutenir la stabilité régionale. Par exemple, la Turquie effectue des reconnaissances aériennes et maritimes 24 heures sur 24 en mer Noire et fournit jusqu’à 70 % des informations sur la situation à l’OTAN et à l’Ukraine.
Un autre sujet est l’intensive coopération militaire et militaro-technique turco-ukrainienne dans le domaine de la fourniture de drones, de véhicules blindés, de divers types d’armes, de la production conjointe de drones et de la modernisation de la marine ukrainienne.
En janvier 2024, Ankara a signé un accord avec la Roumanie et la Bulgarie pour créer un groupe de travail sur la lutte contre les mines en mer Noire (MCM Mer Noire) afin que les trois alliés de l’OTAN puissent lutter conjointement contre les mines marines dérivantes qui menacent la navigation en mer Noire.
La Turquie est également devenue membre du groupement tactique de l’OTAN en Bulgarie et a envoyé quatre avions F-16 et 80 soldats pour renforcer le système national de surveillance aérienne roumain.
Malgré certains désaccords, l’intérêt d’Ankara pour le renforcement de la coopération avec les pays d’Europe occidentale continue de croître. À l’issue de réunions bilatérales en marge du récent sommet de l’OTAN à La Haye, le président Erdogan a déclaré qu’« il serait utile d’inclure les alliés non membres de l’UE dans la nouvelle architecture de sécurité et de défense européenne » et de « considérer les relations Turquie-UE dans une perspective stratégique et à long terme ».
Quelques mois plus tôt, un rapport du Conseil européen des relations étrangères avait été publié. Ce rapport formulait des idées similaires. Le texte soulignait notamment que l’une des raisons pour lesquelles l’Europe devrait intensifier ses relations avec la Turquie est l’incertitude liée aux questions de sécurité européenne face à l’évolution de la politique américaine.
L’accent est mis en particulier sur le fait que « l’administration Trump a clairement indiqué que les Européens doivent assumer davantage de responsabilités en matière de défense… Le retour de Trump aide les dirigeants européens à concrétiser leurs intérêts communs avec la Turquie. »
À cet égard, selon les auteurs du rapport, la mer Noire pourrait devenir l’une de ces zones d’intérêt, offrant à l’UE l’occasion de donner un nouvel élan à ses relations avec le gouvernement turc. À l’avenir, selon eux, la région de la mer Noire pourrait servir de clé vers d’autres zones d’importance stratégique, telles que le Caucase, l’Asie centrale et le Moyen-Orient (principalement la Syrie), où « l’Europe pourrait bénéficier de l’influence établie de la Turquie dans ces régions ».
Néanmoins, malgré ces « jeux européens », si Ankara demeure le porte-étendard de la politique américaine et de l’OTAN dans la région de la mer Noire, elle s’efforce de maintenir un équilibre dans ses relations avec la Russie et de défendre ses priorités nationales.
À cet égard, la déclaration de Erdogan est caractéristique : « Nous sommes tournés vers l’Occident, mais cela ne signifie évidemment pas que nous allons nous détourner de l’Orient, l’ignorer ou ne pas améliorer nos relations. »
La mer Noire demeure, d’une part, un océan agité d’ambitions pour de nombreux acteurs internationaux, mais aussi un océan d’opportunités, offrant des perspectives de convergence d’intérêts, même entre des parties partageant des idéologies différentes. Parallèlement, la Turquie conserve son rôle de maillon central dans cette architecture complexe et en pleine mutation de stabilité et de sécurité régionales.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité..