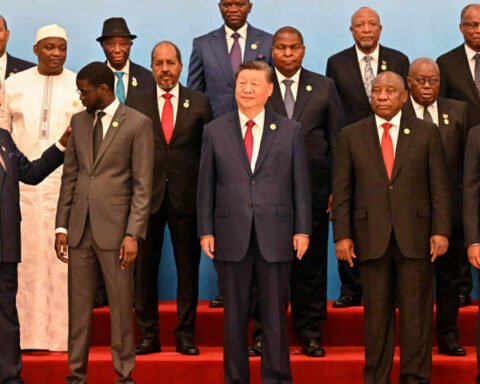À la veille de la Conférence sur le redressement de l’Ukraine, qui s’est tenue à Rome le 10 juillet, on a appris que le géant de l’investissement BlackRock refusait de poursuivre sa participation au projet de redressement.
Selon les médias ukrainiens, le géant de l’investissement avait un rôle clé dans la mobilisation des fonds pour ce qui devait être un “Plan Marshall” moderne pour l’Ukraine.
En 2023, après une rencontre entre Larry Fink, PDG de BlackRock, et le président Zelensky, l’entreprise s’était engagée à coordonner les investisseurs et à élaborer une stratégie d’investissement aux côtés de Kiev. Elle devait annoncer à Rome la levée de milliards auprès d’institutions privées et bancaires occidentales. Pourtant, rien n’a été communiqué.
Certaines sources attribuent ce silence à l’orientation politique du président américain Donald Trump, qui souhaite mettre fin à la guerre selon ses propres règles, souvent peu favorables à Kiev. Andrew Forrest, milliardaire australien co-initiateur du fonds, a quant à lui déjà exprimé ses doutes sur l’utilité de reconstruire un pays à qui une paix imposée ne garantirait ni souveraineté ni stabilité.
Aujourd’hui, l’incertitude plane sur la coordination des financements. D’autres pistes sont envisagées, notamment en France, mais sans le soutien américain, leur réalisation reste hypothétique.
Fin juin, lors d’un forum à Londres, la vice-ministre ukrainienne des Finances, Olga Zykova, annonçait que Kiev n’avait reçu que 7,4 milliards sur les 17,3 milliards de dollars jugés indispensables cette année pour la relance économique. Sur dix ans, les besoins globaux avoisineraient les 524 milliards.
À Rome, le Premier ministre Denys Shmyhal a revu ces chiffres à la hausse : la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine coûteraient environ 1 000 milliards de dollars sur 14 ans. Il distingue deux fonds :
• Le « Fonds ukrainien », de 540 milliards de dollars, financé par les avoirs russes gelés et une taxe sur les exportations russes.
• Le Fonds structurel européen pour l’Ukraine, de 460 milliards, destiné à attirer l’investissement privé européen dans la production nationale.
Shmyhal s’est voulu rassurant, affirmant que l’Ukraine disposait de ressources suffisantes pour couvrir son déficit budgétaire de 19 milliards en 2025. Mais il a aussi évoqué la nécessité de trouver un appui financier pour 2026 et 2027, en appelant les partenaires européens à cofinancer la défense ukrainienne. L’armée coûterait 50 milliards d’euros par an en temps de paix, sans les armements, et Kiev souhaite que l’UE en prenne la moitié à sa charge.
Cette proposition de « cofinancement de l’armée ukrainienne » est révélatrice. Elle fournit un argument commode aux dirigeants européens comme Emmanuel Macron, qui pourront justifier leur soutien à l’Ukraine au nom de la sécurité du continent.
Les chiffres sont imposants, les projets ambitieux. Mais une chose devient claire pour les Européens : l’Ukraine coûte cher, et la sécurité européenne, encore plus.
L’intervention du président tchèque a surpris : selon lui, après un accord de paix, il faudra reprendre la coopération avec la Russie. Il affirme que continuer indéfiniment à combattre Moscou ne ferait qu’accroître les pertes humaines et affaiblir les économies européennes. Il plaide donc pour un cessez-le-feu, suivi de négociations de paix, estimant que la Russie finira par céder sous la pression économique.
Ce discours oscille entre réalisme stratégique et rhétorique européenne : d’un côté, une reconnaissance implicite des limites de l’effort militaire ; de l’autre, l’espoir d’une Russie plus conciliante qu’elle ne l’a jamais été.
Avant Rome, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, déclarait que toute demande de démilitarisation de l’Ukraine était inacceptable. À ses yeux, on ne peut refuser à l’Ukraine l’entrée dans l’OTAN et, en même temps, l’empêcher de disposer d’une armée.
Ce type de discours s’inscrit dans une logique où la guerre devient un moteur économique. Car derrière l’idéalisme affiché, le complexe militaro-industriel européen voit dans ce conflit un levier de croissance.
Mais si l’Ukraine reste militarisée, une reconstruction stable devient quasi impossible. Cela risque de transformer le pays en gouffre financier pour l’Europe – ce qui n’est pas sans séduire certains intérêts politico-économiques.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la création d’un fonds européen de reconstruction, avec une première enveloppe de 10 milliards d’euros.
Mais les annonces les plus intéressantes sont venues de la Pologne et des États-Unis. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a clairement exprimé ses ambitions : la Pologne veut profiter économiquement de la reconstruction.
En avril déjà, il affirmait que Varsovie ne serait pas solidaire sans retour sur investissement. La Pologne veut être à la fois partenaire et bénéficiaire.
Côté américain, Keith Kellogg, représentant spécial de Trump, a réaffirmé l’engagement des États-Unis, parlant d’un nouveau « plan Marshall » déjà en marche. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessant, a précisé que ce fonds serait supervisé directement par Trump, censé ouvrir la voie à un avenir d’« abondance économique » pour l’Ukraine.
Un forum tenu en Ukraine avant le sommet de Rome, intitulé « Du dialogue au partenariat », a été inauguré par Zelensky, qui a affirmé que le pays produisait déjà 40 % de ses armes. Les principaux investissements étrangers sont dirigés vers le secteur militaire.
Natalia Emchenko, du groupe SCM (de Rinat Akhmetov), a résumé la situation :
1. Les capitaux privés étrangers ne veulent pas investir tant que la guerre continue.
2. Les entreprises ukrainiennes sont devenues les premiers investisseurs de la reconstruction.
3. En 2024, elles ont investi près d’un milliard de dollars, soit 19 % de plus que l’année précédente.
4. Pour attirer les investisseurs étrangers, il faut garantir une assurance contre les risques de guerre. Or, cette condition-clé reste floue et non assurée.
Une vérité simple mais dérangeante s’impose: l’économie et la guerre ne font pas bon ménage. Tant que les combats se poursuivent et que les infrastructures civiles sont utilisées à des fins militaires, les investisseurs se tiendront à distance. Les entreprises ukrainiennes sont donc contraintes de jouer le rôle de vitrine et d’intermédiaires pour capter les flux financiers internationaux.
En conclusion, la conférence de Rome s’est achevée sans engagements financiers significatifs. L’Ukraine espérait un plan Marshall, mais le contexte actuel est bien différent : il ne s’agit pas d’un pays vaincu à reconstruire, mais d’un pays en guerre, dont l’avenir économique reste suspendu à la poursuite – ou non – du conflit..
L’opinion de l’auteur peut ne pas coïncider avec la position du comité de rédaction.