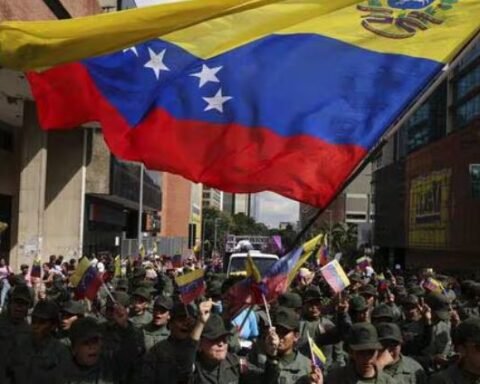Dans son article du 26 avril 2025, intitulé « Wall Street : la dernière force qui peut encore contenir le président Donald Trump » , Sam Rainsy dresse un tableau captivant, mais finalement trompeur : les forces anonymes du capital financier – incarnées par Wall Street – constituent le dernier frein à l’emprise de l’exécutif.
Il pointe les turbulences des marchés suite aux annonces de tarifs douaniers drastiques de Trump, les remaniements de la Réserve fédérale et les mesures agressives de « l’Amérique d’abord » comme preuve que Wall Street discipline les excès présidentiels lorsque les institutions politiques traditionnelles échouent.
Son argument, aussi bien intentionné soit-il, repose sur une prémisse fatalement erronée : les marchés, guidés par des calculs de profit immédiat, peuvent servir de gardiens de la démocratie, de la moralité ou de la stabilité mondiale.
Cette confiance en Wall Street comme force de contrainte n’est pas seulement naïve ; c’est un diagnostic erroné et dangereux du fléau systémique plus profond qui affecte non seulement les États-Unis, mais aussi l’ordre mondial.
En réalité, l’intronisation des marchés financiers comme boussole morale de facto à la gouvernance accélère l’effondrement même qu’ils prétendent prévenir – sur les plans social, économique, écologique et philosophique.
I. Le marché n’est pas une entité morale
Les marchés réagissent au risque, non au bien ou au mal. Ils ne déplorent pas l’injustice ; ils la valorisent. Comme l’a montré le prix Nobel Amartya Sen, les marchés excellent dans l’allocation des biens, mais ignorent le raisonnement moral (Le Développement comme Liberté , 1999).
Ils ne font pas la distinction entre un tarif douanier qui dévaste des millions de travailleurs cambodgiens et un tarif douanier qui ne fait que modifier la répartition des portefeuilles des traders de Goldman Sachs. Wall Street ne « restreint » rien au sens éthique du terme ; elle cherche simplement à protéger la valeur des actifs.
L’article de Sam Rainsy repose sur un postulat fondamentalement erroné : les marchés financiers mondiaux, fruits des intérêts des élites et du pouvoir supranational, devraient servir de régulateurs souverains aux gouvernements démocratiquement élus.
Il trahit un élitisme alarmant qui considère la stabilité financière comme une fin en soi, même lorsque cette stabilité a été obtenue au détriment de la dignité nationale, de la prospérité nationale et de l’action démocratique.
En revanche, l’approche du président Trump en matière d’économie politique ne constitue pas une menace inconsidérée, mais une correction démocratique nécessaire à des décennies de fondamentalisme de marché.
Ses politiques populistes reflètent la volonté de millions de citoyens de la classe ouvrière qui ont vu leurs moyens de subsistance sacrifiés sur l’autel de l’orthodoxie financière mondiale.
Ainsi, lorsque Trump « ajuste » sa politique face à l’effondrement des marchés, ce n’est pas parce que Wall Street agit en sage censeur. C’est parce que le capital exige sa propre stabilité, même si la société dans son ensemble s’effondre.
Les réflexes du marché ne sont pas alignés sur l’épanouissement humain, la souveraineté nationale, ni même la survie démocratique ; ils sont alignés sur l’extraction de rentes à court terme.
Le philosophe Karl Polanyi avertissait dans La Grande Transformation (1944) que lorsque les marchés se détachent des besoins sociaux, ils détruisent le tissu même de la civilisation. Si nous considérons Wall Street comme notre ultime rempart, nous avons déjà perdu la guerre la plus profonde pour l’âme de l’humanité.
II. Le capital financier est l’architecte — et non l’antidote — de l’instabilité mondiale
Loin de freiner les tendances autoritaires de Trump, Wall Street – et le système financier international dans son ensemble – les favorise . Les mêmes flux de capitaux spéculatifs qui poussent les dirigeants à « corriger » les politiques commerciales déstabilisatrices financent également des mouvements politiques, des lobbyistes et des institutions qui creusent les inégalités, fracturent les sociétés et alimentent les réactions populistes qui donnent du pouvoir à des personnalités comme Trump.
En effet, la crise financière de 2008, provoquée par le comportement imprudent et prédateur de Wall Street, a jeté les bases de l’effondrement mondial de la confiance dans les élites, les institutions et la gouvernance technocratique.
Comme Thomas Piketty l’a minutieusement documenté dans Le Capital au XXIe siècle (2013), les inégalités de richesse, exacerbées par la financiarisation, ont été le terreau fertile de révoltes nationalistes et autoritaires à travers le monde.
Ainsi, imaginer que Wall Street puisse contenir Trump – alors qu’il a contribué à créer le trumpisme – revient à confondre l’incendiaire avec le pompier.
III. Les marchés sont les serviteurs et non les maîtres de la souveraineté
L’affirmation centrale de Rainsy – selon laquelle Wall Street constitue le « contrôle » ultime du pouvoir de Trump – inverse l’ordre normal de la gouvernance. Les nations démocratiques existent pour servir leurs citoyens, et non pour obéir aux diktats des marchés financiers.
Comme l’a observé le regretté économiste de Harvard Dani Rodrik dans « Le Paradoxe de la mondialisation » (2011), il existe une tension insoluble entre la finance hypermondialisée et la démocratie nationale.
Lorsque les investisseurs ont la possibilité de sanctionner instantanément les gouvernements qui exercent un contrôle sur les politiques commerciales, monétaires ou du travail, la démocratie elle-même est soumise aux caprices des obligataires et des gestionnaires de fonds anonymes.
Les politiques tarifaires du président Trump, largement décriées par l’élite financière, étaient un effort pour reconquérir la souveraineté industrielle – pour relancer la production nationale, réaffirmer une concurrence loyale et inverser des décennies de désindustrialisation qui ont vidé le cœur de l’Amérique.
Prétendre que les marchés devraient sanctionner ces agissements revient à soutenir que le capital transnational – et non les électeurs – devrait déterminer la politique des États-Unis. Une telle pensée est l’antithèse même de la démocratie.
IV. Le pouvoir de Wall Street mine la démocratie partout
Chaque être humain sur Terre est concerné par les décisions des marchés financiers. Wall Street n’est pas seulement une institution américaine ; c’est une force planétaire qui façonne le destin des agriculteurs indiens, des tisserands africains, des ouvriers vietnamiens, des écoliers boliviens et des retraités allemands.
Lorsque les marchés paniquent à cause des droits de douane, la douleur n’est pas répartie uniformément. Les marchés émergents subissent un effondrement monétaire, provoquant une inflation qui détruit l’épargne des populations pauvres du monde. (Voir : Reinhart et Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly , 2009.)
Une chute de 6 % du S&P 500 peut réduire de plusieurs millions le bilan d’un fonds spéculatif, mais une dévaluation de 30 % de la roupie pakistanaise signifie la famine pour des dizaines de milliers de personnes.
La « discipline » financière exige souvent des mesures d’austérité qui réduisent les services publics essentiels dans les pays en développement, sous couvert de stabilisation des marchés.
Rainsy dépeint implicitement le nationalisme économique de Trump comme déstabilisateur, mais ignore la déstabilisation plus profonde provoquée par les forces du marché qu’il célèbre.
Comme l’ont montré le regretté sociologue Immanuel Wallerstein et l’économiste Thomas Piketty ( World-Systems Analysis , 2004 ; Capital and Ideology , 2020), le capitalisme financier mondialisé a creusé les inégalités au sein des nations à des niveaux jamais vus depuis l’Âge d’or.
Le « coup de poing de Trump » — la chute brutale des marchés après les annonces de Trump sur les tarifs douaniers — ne doit pas être perçu comme la preuve d’une gouvernance irresponsable, mais comme un conflit salutaire entre les revendications démocratiques populaires et le capitalisme mondial bien ancré.
La chute des marchés n’est pas due à l’irrationalité des politiques de Trump, mais à leur menace pour la rentabilité d’un système international profondément injuste qui freine les salaires, délocalise la production à l’étranger et prive les travailleurs nationaux de leur pouvoir d’action.
En effet, la perte de 6,6 billions de dollars citée par Rainsy n’est pas de l’argent « perdu » pour l’humanité – c’est de l’argent extrait de positions financières spéculatives, dont beaucoup sont déconnectées de l’activité économique réelle et productive.
Le projet du président Trump vise à réancrer la prospérité américaine dans le travail réel – usines, exploitations agricoles, infrastructures – plutôt que dans des abstractions financières fragiles. Il ne s’agit pas de chaos ; il s’agit d’une tentative de restaurer une conception plus ancienne et plus solide de l’économie politique.
Ainsi, si nous acceptons Wall Street comme dernier contrôle du pouvoir, nous confions en réalité le sort de milliards de personnes à un comité invisible de banquiers d’investissement et de gestionnaires d’actifs qui ne répondent à aucun électorat, à aucune constitution, à aucune conscience humaine.
V. L’illusion de la retenue : retraites tactiques pour permettre l’expansion stratégique
Les épisodes de « Trump Thump » cités par Rainsy – brefs effondrements des marchés après des droits de douane ou des licenciements – ne prouvent pas que Trump soit véritablement maîtrisé. Ils montrent simplement qu’il recule stratégiquement lorsque cela est nécessaire pour consolider son pouvoir de manière plus durable.
Les marchés ne punissent pas l’autoritarisme en soi. Ils punissent l’incertitude . Si Trump (ou tout autre dirigeant) peut promettre « ordre » et « prévisibilité » — même par des moyens antidémocratiques — les marchés le récompenseront souvent.
Les exemples historiques abondent :
En 1973 après le coup d’État militaire du général Pinochet au Chili, les marchés financiers ont grimpé en flèche parce que son régime offrait une stabilité aux investisseurs multinationaux — au prix de milliers de citoyens torturés et disparus. (Klein, The Shock Doctrine , 2007).
De même, la « stabilité » autoritaire en Arabie saoudite est systématiquement récompensée par les investisseurs malgré les violations grotesques des droits de l’homme.
Les marchés sont structurellement biaisés en faveur de politiques qui maximisent les profits à court terme et la mobilité des capitaux, souvent au détriment de la stabilité sociétale à long terme. Ils ne récompensent ni la justice, ni la dignité nationale, ni la force communautaire. Ils privilégient la déréglementation, l’arbitrage du travail et l’exploitation environnementale.
Ainsi, la brève volatilité de Wall Street en réponse aux faux pas de Trump ne constitue pas un obstacle à l’autocratie ; il s’agit simplement d’une exigence de gestion compétente de l’autocratie.
La volonté du président Trump de défier les attentes du marché ne reflète pas une imprudence, mais une réaffirmation du pouvoir politique sur le pouvoir financier – un rééquilibrage nécessaire après des décennies durant lesquelles les marchés ont assumé leur autorité souveraine.
VI. La véritable retenue doit venir des sociétés démocratiques, et non des marchés financiers.
Si la civilisation veut survivre à ce siècle, la dernière mesure de restriction à l’excès de pouvoir de l’exécutif doit venir de citoyens mobilisés, d’institutions politiques réformées et d’un réveil de l’imagination éthique – et non des rapports trimestriels sur les bénéfices.
L’économiste Dani Rodrik a maintes fois soutenu dans Straight Talk on Trade , 2017 que les marchés doivent être « intégrés » aux sociétés démocratiques, et non autorisés à les gouverner. Lorsque les marchés financiers usurpent les freins et contrepoids constitutionnels, la démocratie devient ornementale.
En d’autres termes, un marché haussier ne remplace pas l’État de droit.
Si les Américains (et tous les citoyens du monde) souhaitent contenir des personnalités comme Trump – ou leurs futurs homologues à travers le monde – ils ne doivent pas abdiquer leur responsabilité au profit de Wall Street.
Ils doivent reconstruire la résilience démocratique : éducation civique, médias indépendants, lois anti-monopole, réforme du financement des campagnes électorales et nouvel ordre économique international fondé sur la justice plutôt que sur la simple « efficacité ».
Sinon, chaque nation devient l’otage de ce que Jacques Derrida appelle « l’auto-immunité » de la mondialisation : un système qui érode ses propres fondements tout en semblant offrir une protection.
Rainsy décrit l’approche tarifaire de Trump comme une recette pour la contraction économique. Pourtant, les précédents historiques suggèrent le contraire.
Du Rapport sur les industries manufacturières d’Alexander Hamilton (1791) au nationalisme économique de Franklin D. Roosevelt pendant le New Deal, les politiques protectionnistes ont souvent été essentielles au développement des industries nationales et à la stabilisation des sociétés démocratiques.
Comme l’a soutenu l’historien économique Ha-Joon Chang dans Kicking Away the Ladder (2002), toutes les nations aujourd’hui développées ont eu recours à des politiques protectionnistes à des moments clés de leur histoire, n’adoptant le libre-échange que plus tard, une fois leurs industries arrivées à maturité.
Les tarifs douaniers du président Trump ne visent pas à détruire le commerce international, mais à renégocier ses termes afin de mieux refléter les intérêts américains – un intérêt historiquement reconnu comme légitime sous les administrations républicaines et démocrates.
L’accent mis par Trump sur le commerce réciproque, la concurrence loyale et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement anticipe le monde de rivalité multipolaire qui émerge – un monde dans lequel la foi naïve dans le mondialisme du laissez-faire sera un handicap stratégique.
Enfin, Rainsy passe à côté des véritables enjeux mondiaux. Le danger n’est pas que le nationalisme économique de Trump déstabilise les marchés. Le danger est que si les revendications populistes en faveur de la dignité, d’un travail équitable et de la souveraineté nationale sont systématiquement écrasées par la panique des marchés, des mouvements plus extrêmes – et potentiellement antidémocratiques – surgiront à leur place.
Nous en voyons déjà les signes partout dans le monde : dans la résurgence des mouvements radicaux de gauche et de droite, dans l’effondrement des partis centristes et dans la méfiance généralisée envers les institutions internationales comme l’OMC et le FMI.
Le choix n’est pas entre la stabilité du marché et le nationalisme populiste. Il s’agit plutôt d’une réaffirmation démocratique de l’économie politique – comme le prône Trump – ou d’une érosion continue de la légitimité démocratique conduisant à un effondrement systémique.
Si les marchés financiers continuent de dicter les résultats politiques, nous pourrions bien être confrontés à un avenir où l’autonomie démocratique sera remplacée par une oligarchie technocratique – un monde dans lequel les élections ne sont que de simples rituels et où le véritable pouvoir réside dans des flux financiers invisibles, hors de portée de tout citoyen.
Le président Trump, quels que soient ses défauts, reconnaît ce danger. Sa politique reflète une tentative, aussi imparfaite soit-elle, de restaurer la primauté de la politique sur l’argent – celle des électeurs sur les investisseurs en capital-risque.
L’article de Sam Rainsy idéalise Wall Street comme le gardien impartial de l’ordre mondial. En réalité, la finance mondiale est indifférente à la démocratie, aveugle à la justice et nuisible à la souveraineté.
Le populisme « America First » du président Trump représente une tentative de rétablir cet équilibre – de reconquérir l’autodétermination démocratique sur la vie économique. Il s’agit d’une tentative de restaurer la dignité du travail, la souveraineté de l’État-nation et la centralité de la politique dans la construction d’un avenir commun.
Cette bataille n’est pas seulement celle des États-Unis. Chaque société doit se confronter à la même question fondamentale : serons-nous gouvernés par la volonté des citoyens ou par la main invisible des marchés ?
En choisissant la première option, Trump ne se présente pas comme une menace pour l’ordre mondial, mais comme un signe avant-coureur de son nécessaire renouveau.
L’analyse ci-dessus exprime le point de vue de son auteur et s’inscrit dans une démarche de réflexion, sans prétention à l’exhaustivité ni à l’unanimité.